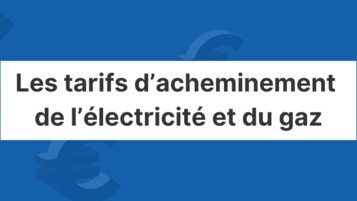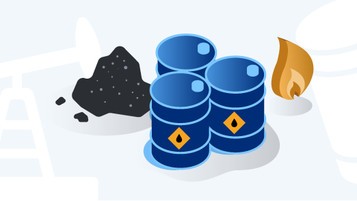Comprendre le fonctionnement du marché de l’énergie en France

Un devis moins cher pour l’électricité ou le gaz ?
Contactez Selectra pour faire votre choix :

L'offre du moment à -15,5% (HT) par rapport au tarif réglementé
De l'électricité verte à prix fixe moins chère
En France, l’électricité est produite majoritairement à partir de nucléaire et d’énergies renouvelables, et le gaz naturel est largement importé via des gazoducs et des terminaux méthaniers. L’électricité et le gaz transitent par des réseaux de transport et de distribution jusqu’aux consommateurs finaux. Une partie de la production nucléaire est accessible aux fournisseurs via l’ARENH à un tarif régulé, tandis que le marché de gros fixe les prix pour le reste de l’électricité et pour le gaz ; à moins que les fournisseurs ne s'approvisionnent via des contrats de long terme. En parallèle, la transition et l'émancipation énergétiques s’accélèrent avec le développement de l’autoconsommation, des batteries et de la mobilité électrique, qui transforment en profondeur le marché de l'énergie.
Comment est organisé le marché de l’énergie en France ?
Le système énergétique français repose sur une chaîne structurée en quatre étapes clés : production, transport, distribution et fourniture, chacune jouant un rôle déterminant dans l’approvisionnement et la gestion de l’énergie.

La production d’énergie
La production d’énergie en France repose sur un mix énergétique varié, qui inclut le nucléaire comme pilier principal, les énergies renouvelables (solaire, éolien, hydraulique, biomasse) et, dans une moindre mesure, les énergies fossiles (essence et gaz essentiellement) qui sont largement importées.
Cette diversité permet de répondre aux besoins énergétiques tout en augmentant la résilience du système face aux variations de production, notamment pour les sources intermittentes comme l’éolien et le solaire.
En parallèle, le stockage d’énergie, notamment pour le gaz naturel, joue un rôle essentiel. Les infrastructures de stockage permettent de lisser les fluctuations de la demande, en particulier pendant les périodes de pointe hivernale, et d'assurer une sécurité d'approvisionnement en cas de tensions sur les importations.
Le transport de l’énergie

Le transport repose sur des infrastructures nationales et internationales de premier plan. Pour le gaz naturel, les méthaniers (avec du gaz liquéfié) et les gazoducs opèrent sous la supervision des gestionnaires de réseaux de transport comme NaTran (ex-GRTgaz) et Terega, qui assurent l’acheminement depuis les points d’entrée sur le territoire.
Pour l’électricité, RTE gère les lignes à haute tension qui connectent les sites de production aux grands centres de consommation, tout en garantissant la stabilité du réseau grâce à des interconnexions avec les pays voisins. Ces infrastructures sont cruciales pour maintenir un équilibre constant entre offre et demande et pour sécuriser l’approvisionnement énergétique.
La distribution de l’énergie
Une fois transportée, l’énergie est prise en charge par les gestionnaires de réseaux de distribution, Enedis pour l’électricité et GRDF pour le gaz. Ces opérateurs gèrent les infrastructures de moyenne et basse tension, ainsi que les réseaux de canalisations, pour acheminer l’énergie jusque dans les foyers, entreprises et bâtiments publics.
Ils sont également responsables de la maintenance des réseaux et de la gestion des compteurs.
La fourniture d’énergie
La vingtaine de fournisseurs d’énergie en France assure la vente d’électricité et de gaz aux consommateurs finaux. Quand ils ne la produisent pas ou pas assez, ils achètent l’énergie dont ils ont besoin pour leurs clients sur les marchés de gros ou directement auprès des producteurs, puis collaborent avec Enedis et GRDF pour s'assurer que l’acheminement se fasse jusqu’aux foyers et entreprises.
Le rôle des fournisseurs ne se limite pas à la simple vente : ils doivent proposer des offres adaptées à la consommation et aux attentes des consommateurs, tout en garantissant une facturation transparente. La concurrence entre fournisseurs stimule l’innovation, notamment en matière de services et de solutions pour la transition énergétique, comme les offres d’autoconsommation ou de mobilité électrique.
Et l'essence ?
Le marché de l’essence en France commence par l’importation ou la production nationale de pétrole brut, transformé dans les raffineries en carburants comme le SP95 ou le SP98. Les distributeurs, via des réseaux de transport et de stockage, approvisionnent ensuite les stations-service.
Ces carburants sont proposés aux consommateurs finaux, notamment pour les véhicules, avec des prix influencés par les coûts de production, les taxes, et les fluctuations des marchés internationaux.
Soulignons la croissance continue des biocarburants et du gaz naturel pour véhicules (GNV) comme alternatives plus durables.
Et les GPL ?
Le marché des GPL (gaz de pétrole liquéfié) repose sur la production issue du raffinage du pétrole et de l’extraction du gaz naturel. Les GPL, principalement le propane et le butane, sont transportés sous forme liquide par camions ou navires jusqu’aux sites de stockage ou aux points de distribution. Ils sont ensuite commercialisés auprès des consommateurs pour des usages domestiques (chauffage, cuisson) ou industriels, ainsi que pour l’automobile via le GPL-carburant.
La compétitivité des GPL est liée à leur prix attractif, leur transport et leur disponibilité (en cuve ou en bouteilles). Une poignée d'acteurs se partage le marché des citernes, alors que les supermarchés dominent celui des bonbonnes.
Et le bois ?
Le marché du bois énergie en France repose sur une chaîne complète allant de la récolte forestière à la consommation finale pour le chauffage domestique ou industriel.
Le bois, sous forme de bûches, granulés ou plaquettes, est collecté, transformé et distribué par des fournisseurs spécialisés. Il est prisé pour son rôle dans la transition énergétique en tant que source renouvelable et locale, bien que son prix soit influencé par la demande croissante, les coûts de transport et la gestion durable des ressources forestières.
Le mix énergétique français : production et consommation
Le mix énergétique consiste en la répartition de la provenance des différentes énergies que l’on consomme. C’est de quoi est composée l’énergie que nous consommons.
Il illustre l’équilibre entre diverses sources de production et les besoins de consommation.
Production d'énergie en France
La production primaire d’énergie en France a été marquée par une forte domination du nucléaire, atteignant 1 025 TWh, complétée par une production significative d’énergies renouvelables : l’électricité renouvelable a contribué à hauteur de 132 TWh, répartie entre l’hydraulique (56 TWh), l’éolien (52 TWh) et le photovoltaïque (23 TWh). Les énergies renouvelables thermiques et la valorisation des déchets ont généré 253 TWh, dont la biomasse solide représente la plus grande part avec 119 TWh. Les pompes à chaleur ont produit 50 TWh, suivies par le biogaz (21 TWh) et les biocarburants (21 TWh).
La production primaire d’énergie fossile, quant à elle, reste marginale avec seulement 10 TWh. La production de gaz naturel et de pétrole sont résiduelles en France.
Le mix énergétique français en %
Graphique : Selectra - Source : Chiffres clés de l'énergie - Édition 2023 - Ministère de la Transition Énergétique
%
Le mix énergétique français a une place particulière dans le monde en raison de sa grande domination par le nucléaire.
La production nationale d’électricité est bien plus élevée que celle de gaz, malgré l'essor des unités de biométhane produisant du biogaz dans nos campagnes.
Le mix électrique français en %
Source : Chiffres clés de la production d’électricité française en 2024 RTE - Graphique : Selectra
%
Le nucléaire
En France, l’essentiel de l'énergie consommée provient des 57 réacteurs composant le parc nucléaire du pays.
Le nucléaire a longtemps été la fierté de la France, symbole d'indépendance énergétique et de maîtrise technologique, avec un parc de réacteurs parmi les plus performants au monde. Si sa place est importante, c’est parce qu’à la suite du premier choc pétrolier dans les années 1970, une série de mesures a été prise par les gouvernements afin de rendre la France autosuffisante en termes de production d’électricité.
Cette énergie est ensuite devenue une source d'embarras face aux enjeux de sécurité, aux retards des nouveaux projets comme l’EPR, et aux débats sur ses déchets. Aujourd'hui, le nucléaire connaît un retour en grâce comme pilier de la transition énergétique, et la France reste unique par son mix énergétique dominé à environ 70 % par cette énergie, faisant d'elle le pays le plus nucléarisé du monde et lui offrant une faible empreinte carbone par rapport à ses voisins européens.
Les énergies renouvelables
Les énergies renouvelables proviennent de ressources naturelles inépuisables comme le soleil, le vent, l’eau ou la biomasse. Leur principal atout réside dans leur faible impact environnemental, notamment en termes d’émissions de CO2, et leur contribution à la diversification du mix énergétique, réduisant ainsi la dépendance aux énergies fossiles et nucléaires.
Cependant, elles présentent des limites, notamment leur intermittence (vent, soleil) et la nécessité d’infrastructures de stockage ou de complémentarité avec d’autres sources pour assurer un approvisionnement stable. De plus, leur déploiement peut entraîner des contraintes environnementales ou sociétales, comme l’impact visuel des parcs éoliens, les besoins fonciers des centrales solaires ou le trafic routier autour des unités de biométhane.

La France a commencé à développer ses énergies renouvelables avec l’hydroélectricité, qui reste aujourd’hui la première source de production renouvelable grâce à de grands barrages et à l’unique usine marémotrice au monde située à La Rance. L’éolien terrestre a pris le relais avec une forte expansion dans les plaines et collines du pays, suivi par les investissements dans l’éolien offshore, qui visent à exploiter le potentiel des côtes françaises. Le solaire connaît une progression rapide, soutenu par des politiques d’incitation et une baisse des coûts technologiques, tandis que le biogaz, la valorisation des déchets et la géothermie complètent ce mix renouvelable.
Aujourd’hui, les énergies renouvelables sont la quatrième source d’énergie consommée en France et la deuxième source de production nationale, derrière le nucléaire, avec une répartition dominée par l’hydraulique, suivie de l’éolien, du solaire, et enfin du biogaz et des déchets.
Les énergies fossiles
Les énergies fossiles, issues de la combustion du pétrole, du gaz naturel et du charbon, sont historiquement les principales sources d’énergie dans le monde. Leur principal avantage réside dans leur forte densité énergétique, leur disponibilité et leur facilité de stockage et de transport, ce qui les a rendues indispensables au développement industriel et économique. Cependant, elles présentent de nombreux inconvénients : leur combustion pollue et génère des gaz à effet de serre contribuant au changement climatique, leur extraction peut dégrader les écosystèmes, et leur disponibilité est limitée, entraînant parfois des hausses des coûts et des tensions géopolitiques. La dépendance à ces ressources pose ainsi des problèmes stratégiques en cas de crise internationale.
La France s’est progressivement détachée des énergies fossiles grâce à son parc nucléaire. Le fioul a été presque entièrement remplacé par l’électricité dans la production d’énergie, et la consommation de charbon, qui reste résiduelle en hiver pour alimenter les dernières centrales encore en activité, devrait disparaître avec leur fermeture prévue dans les prochaines années. La consommation de gaz naturel connaît une forte diminution, accélérée par la crise en Ukraine, qui a exacerbé les tensions sur les approvisionnements. Cette baisse concerne aussi bien l’utilisation domestique que la production d’électricité, via les centrales thermiques.
Ces évolutions placent la France en avance dans la réduction de la dépendance aux énergies fossiles par rapport à d’autres pays, tout en renforçant son mix énergétique faible en carbone.
Importations et exportations d'énergie
Sur le plan des échanges, la France a exporté 50 TWh d’électricité nette en 2023, un retour à un solde exportateur notable après un déficit de 15 TWh l’année précédente. Les importations nettes de gaz naturel se sont élevées à 339 TWh, tandis que celles de pétrole brut ont atteint 540 TWh. Les produits raffinés ont affiché des importations nettes de 271 TWh, et les biocarburants importés ont contribué à hauteur de 20 TWh. À noter également l’importation de bois à des fins énergétiques, représentant 3 TWh.
Evolution des échanges d'électricité entre la France et l'Europe - 2011-2025
Source : RTE Bilan Électrique 2025 - Graphique : Selectra
TWh
Provenance des importations de gaz naturel de la France
Source : Ministère de la Transition Écologique - Graphique : Selectra
En % et en TWh au passage de la souris
Les échanges entre pays se font par les infrastructures transfrontalières des interconnexions électriques et gazières. Pour l’électricité, il s’agit de lignes à haute tension reliant les réseaux nationaux, permettant d’exporter les surplus de production ou d’importer en cas de besoin, renforçant ainsi la sécurité d’approvisionnement et la stabilité des réseaux. Pour le gaz, les interconnexions prennent la forme de gazoducs reliant les infrastructures nationales, facilitant les importations depuis des producteurs majeurs comme la Norvège, ou les échanges entre pays européens. Ces dispositifs jouent un rôle clé dans l’intégration des marchés et la gestion des fluctuations de production et de consommation, tout en améliorant la résilience énergétique face aux crises ou aux pics de demande.
Indépendance énergétique et bilan économique
Le taux d’indépendance énergétique de la France a progressé à 56,3 % en 2023, soutenu par une augmentation de la production nucléaire et renouvelable.
Cette amélioration a contribué à réduire la facture énergétique nationale à 61,2 milliards d’euros, contre 124,1 milliards d’euros l’année précédente. En matière d’électricité, le solde monétaire des échanges a été largement excédentaire, atteignant 3,9 milliards d’euros, une nette amélioration par rapport au déficit de 7,8 milliards d’euros enregistré précédemment.
La libéralisation du marché de l’énergie
Le marché de l’électricité et le marché du gaz en France s'est ouvert entre 1999 et 2007.
L’ouverture à la concurrence côté fournisseur
La libéralisation du marché de l’électricité et du gaz en France s’est faite en plusieurs étapes et vient de directives de l’Union européenne et du Parlement Européen.
En 1999, les entreprises consommant plus de 100 GWh par an ont pu choisir leur fournisseur d’électricité, marquant la première ouverture du marché. En 2004, cette possibilité a été élargie aux professionnels pour l’électricité et aux consommateurs de gaz consommant plus de 5 GWh par an. En juillet 2007, la libéralisation a été étendue à tous les particuliers et professionnels, leur permettant de choisir librement entre les fournisseurs historiques (EDF et GDF) et les nouveaux fournisseurs alternatifs.

Ces évolutions visent à renforcer la concurrence, diversifier les offres et garantir de meilleurs prix.
Avant cette date, les Français n’avaient pas le choix du fournisseur pour leur énergie : les fournisseurs historiques avaient le monopole du marché. Ainsi, on ne pouvait se fournir en électricité que via EDF, et son gaz uniquement de GDF, devenu depuis Engie.
Avec l’ouverture du marché, les fournisseurs alternatifs sont apparus : ce sont des entreprises pouvant librement concurrencer EDF et Engie dans la fourniture de gaz et d’électricité. De temps en temps, de nouveaux apparaissent.
Évolution du nombre de fournisseurs d'énergie en France
Nombre de fournisseurs d'énergie avec des offres ouvertes à la souscription sur territoire Enedis / GRDF - Source : Comparateur Selectra et Médiateur de l'Énergie
Le marché de l’énergie n’est pas ouvert à la concurrence sur l'essentiel des territoires des Entreprises Locales de Distribution (ELD), qui ont de fait gardé le monopole historique sur leur zone. Une ELD est une entité qui n’avait pas été nationalisée lors de la création d’EDF et GDF en 1946. Elles assurent encore la distribution et la fourniture d’énergie sur environ 5% du territoire français. Cela limite la présence de fournisseurs alternatifs, sauf à Grenoble et Strasbourg où l'alternatif ekWateur opère.
Les types d’offres pour les particuliers
Il est donc possible de choisir son offre d'électricité tout comme celle de gaz, et de changer de fournisseur comme on veut. Il est d'ailleurs bien possible de revenir au tarif réglementé de l'électricité si on le souhaite.
En France, les consommateurs peuvent choisir parmi une grande variété d’offres d’énergie. Ces offres se distinguent par leur mode de tarification, leur structure, et parfois leur engagement écologique.
Pour toutes les offres d’électricité, deux options tarifaires standardisées permettent d’ajuster les prix à l’usage :
- Base : un tarif unique, quelle que soit l’heure de la journée.
- Heures Pleines / Heures Creuses (HPHC) : propose un tarif réduit pendant les 8 heures creuses (souvent la nuit) et un tarif plus élevé pendant les 16 heures pleines journalières.
Les consommateurs peuvent choisir d'avoir une offre avec de l’énergie verte, garantissant que l’électricité ou du gaz consommé provient de sources renouvelables. Ces offres fonctionnent avec un système de garanties d’origine, qui certifient que l’équivalent de l’énergie consommée est injecté dans le réseau sous forme renouvelable. Certaines offres vont plus loin en soutenant directement des producteurs locaux ou des projets d’énergie verte ; de quoi éviter tout soupçon de greenwashing.
Tarif réglementé
Le tarif réglementé de vente (TRV), fixé par les pouvoirs publics, a longtemps été une référence pour l’électricité et le gaz naturel. Il reflète les coûts de production, de transport et de distribution. Cependant, le TRV pour le gaz a été supprimé en juillet 2023, contraignant les consommateurs à migrer vers des offres de marché. Pour l’électricité, EDF continue de proposer son tarif Bleu pour les particuliers et petits professionnels.
Les tarif jaune et tarif vert pour les entreprises et industries ont eux aussi disparu.
Prix indexé
Les offres à prix indexé suivent un indice de référence, comme le TRV ou un indice de marché. Ces prix varient en fonction des fluctuations de cet indice, tout en offrant souvent une réduction HT (par exemple, -10 % sur le TRV).
Si ces offres permettent de bénéficier des baisses de prix, elles exposent aussi les consommateurs aux hausses. Le prix repère du gaz évolue tous les mois, alors que le tarif réglementé de l'électricité évolue généralement deux fois par an.
Prix fixe
Les offres à prix fixe garantissent un tarif stable pendant une période définie (souvent 1 à 3 ans). Elles protègent les consommateurs des hausses de prix sur le marché, mais ne permettent pas de profiter des baisses.
Idéal pour stabiliser un budget, ce type d’offre est particulièrement apprécié dans un contexte de volatilité des prix de l’énergie.
A ce sujet, retrouvez nos analyses sur les évolutions de prix de l'électricité et les évolutions de prix du gaz naturel.
Prix libres (ni indexés ni fixes)
Les offres à prix libres sont fixées directement par les fournisseurs sans lien avec un indice ou une garantie de stabilité. Elles permettent aux fournisseurs d’ajuster leurs prix selon leurs propres stratégies commerciales. Cependant, leur transparence peut parfois être limitée, ce qui demande une vigilance accrue de la part des consommateurs.
Tarifs dynamiques
Les offres à tarifs dynamiques reflètent directement les variations des prix sur le marché de l’électricité en temps réel ou à intervalles réguliers. Favorisées par l’utilisation des compteurs connectés comme Linky, elles permettent de réduire sa facture en adaptant sa consommation aux heures où les prix sont bas.
Ces offres nécessitent toutefois une gestion active et une capacité d’ajustement des usages. Le fournisseur Barry avait tenté l'aventure juste avant la crise de l'énergie, et n'y a pas survécu.
Tarifs horosaisonniers
Les tarifs horosaisonniers varient selon la saison et donc les variations de demande. Par exemple, Tempo propose des jours bleus (peu chers), blancs (prix intermédiaires) et rouges (très chers), incitant à limiter la consommation pendant les jours rouges. EJP offre un tarif avantageux toute l’année sauf pendant 22 jours de pointe, où les prix augmentent fortement. Cette option n’est plus disponible pour les nouveaux contrats, mais reste en vigueur pour certains anciens abonnés.
La nouvelle Formule Tarifaire d'Acheminement (FTA) introduite en 2024 propose une structure à quatre plages horaires, distinguant les heures pleines et creuses en fonction des saisons. Cette modulation tarifaire incite les fournisseurs à développer des offres horo-saisonnières, permettant aux consommateurs d'ajuster leur consommation en fonction des variations de prix selon les périodes de l'année et les moments de la journée. Enercoop et Ohm Energie ont été les premiers à proposer des offres moins chères en été. De fait, la consommation est plus faible qu'en hiver car la consommation de climatisation est nettement inférieure à celle de chauffage ; alors qu'en parallèle la production solaire est élevée.
Evolution des prix de l'électricité HT pour les particuliers
France - depuis 2021
€/kWh TTC
Evolution des prix du gaz naturel HT pour les particuliers
Evolutions de prix comparées par rapport au tarif réglementé jusqu’en juin 2023, puis selon le prix repère gaz dès août 2023
€/kWh TTC
Enfin, le médiateur national de l’énergie est un recours en cas de litige entre un fournisseur et un client. Il est souvent la dernière solution utilisée par l’une des parties lorsque le dialogue n’a pas pu aboutir à résoudre le différend.
L'ouverture à la concurrence côté production
L’ouverture à la concurrence des producteurs d’électricité découle des directives européennes visant à libéraliser le marché de l’énergie pour favoriser la compétitivité et diversifier les sources de production.
Historiquement dominé par EDF avec ses parcs nucléaire et hydraulique, le marché français s’est progressivement ouvert à de nouveaux acteurs, permettant à des entreprises de produire de l’électricité à partir de sources renouvelables (éolien, solaire) et de biométhane.
Ces producteurs vendent leur électricité sur le marché de gros ou via des contrats directs avec des fournisseurs. Par ailleurs, des mécanismes comme l’ARENH (Accès Régulé à l'Électricité Nucléaire Historique) garantissent à ces derniers un accès à l’électricité nucléaire à un tarif régulé, facilitant leur intégration sur le marché tout en assurant une concurrence se voulant équitable. Ce mécanisme disparaîtra fin 2025.
Dans les faits, peu de fournisseurs produisent en capacité suffisante leur énergie pour les besoins de leurs clients, d'où l'intérêt de se fournir ailleurs.
Notons qu'un mécanisme de capacité impose aux fournisseurs d’énergie de garantir la disponibilité de suffisamment de capacités de production ou d’effacement pour couvrir les besoins de leurs clients lors des périodes de pointe. Les fournisseurs qui ne disposent pas de capacités suffisantes peuvent acheter des certificats de capacité auprès de producteurs ou d’acteurs d’effacement, assurant ainsi la sécurité d’approvisionnement du réseau.
Le monopole sur les activités de transport et de distribution
Le monopole sur les activités de transport et de distribution d'énergie en France s'explique par leur nature d'infrastructures essentielles et stratégiques, qui nécessitent une gestion centralisée pour garantir la sécurité, la fiabilité et l’efficacité du réseau.
Ces réseaux, gérés par des opérateurs uniques comme RTE pour le transport de l’électricité, GRTgaz et Terega pour sur une zone de marché unique pour le gaz, ou Enedis et GRDF pour la distribution, impliquent des investissements très lourds et une maintenance complexe. La concurrence sur ces segments entraînerait des duplications coûteuses et inefficaces. Ce monopole réglementé est permis par un accès équitable pour tous les fournisseurs.
Des tarifs d’acheminement et de stockage composent la facture énergétique. Ils couvrent les coûts liés au transport et à la distribution de l’électricité et du gaz, ainsi qu’au stockage du gaz. Ils servent à garantir l’entretien et le développement des infrastructures et appliqués de manière équitable à tous, assurant notamment un accès non discriminatoire aux réseaux.
- Tarif d’Utilisation des Réseaux Publics d’Électricité (TURPE) : Appliqué à l’électricité, il couvre les coûts d’acheminement via les réseaux de transport (gérés par RTE) et de distribution (gérés par Enedis ou les ELD).
- Tarif d’Utilisation des Réseaux de Transport de Gaz (ATRT) : Il concerne le transport du gaz naturel sur les grands réseaux opérés par GRTgaz et Terega.
- Tarif d’Utilisation des Réseaux de Distribution de Gaz (ATRD) : Appliqué au niveau des réseaux locaux de distribution, il est géré par GRDF ou les ELD gazières.
- Tarif d’Accès des Stockages Régulés de Gaz (ATS) : Il finance le stockage du gaz naturel, indispensable pour garantir la continuité d’approvisionnement, notamment en hiver.
Ces tarifs sont ajustés périodiquement par la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) pour refléter les évolutions des coûts réels des infrastructures tout en encourageant leur modernisation et leur adaptation aux besoins énergétiques.
Les taxes sur l’électricité, le gaz et l’essence
Les taxes énergétiques représentent une part importante du prix payé par les consommateurs en France. Elles visent à financer les infrastructures, encourager la transition énergétique ou alimenter le budget de l’État. Ces taxes, applicables à l’électricité, au gaz et aux carburants, sont réglementées et parfois modulées en fonction des usages ou des consommateurs. Voici les principales taxes :
Sur l’électricité :
- Accise sur l’électricité : Remplaçant les anciennes taxes, elle est appliquée sur la consommation d’électricité et contribue au financement des infrastructures énergétiques et des projets de transition énergétique.
- Contribution Tarifaire d’Acheminement (CTA) : Financement des droits spécifiques des personnels des industries électriques et gazières.
- TVA : Appliquée au taux de 5,5 % pour l’abonnement et de 20 % pour la consommation d’électricité, elle s’ajoute également à certaines taxes.
Décomposition d'une facture au tarif bleu résidentiel (en %)
À jour en février 2026 - Calculs Selectra : moyenne des profils type Base 6 kVA et HPHC 9 kVA
%
Sur le gaz :
- Accise sur le gaz naturel : Elle remplace la TICGN et s’applique sur la consommation de gaz pour financer des projets liés à la transition énergétique et au budget général.
- Contribution Tarifaire d’Acheminement (CTA) : Similaire à celle de l’électricité, elle finance les droits spécifiques des personnels du secteur.
- TVA : Appliquée au taux de 5,5 % pour l’abonnement et de 20 % pour la consommation de gaz, elle s’ajoute aussi à certaines taxes.
Postes de coûts couverts par le Prix Repère de la CRE - Client T2, en %
Données à jour en août 2025 pour le mois de septembre 2025 - T2 correspond à une utilisation du gaz pour le chauffage - Pour une consommation de 11 510 kWh/an - Source : CRE - Graphique : Selectra
%
Sur l’essence et les carburants :
- Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Énergétiques (TICPE) : Prélevée sur les carburants comme l’essence, le diesel et le GPL, elle constitue l’une des principales sources de recettes fiscales.
- Taxe Carbone (incluse dans la TICPE) : Encourage la réduction des émissions de CO2 en augmentant le coût des énergies fossiles.
- Taxe Régionale sur les Carburants : Appliquée dans certaines régions, elle s’ajoute à la TICPE.
- TVA : Appliquée à 20 %, y compris sur les taxes comme la TICPE, elle augmente le prix final payé par les consommateurs.
Décomposition du prix du SP95 (1,75 €/l) au 11 octobre 2024
Provenance des données : energiesetmobilites.fr - Sources : DGEC - Graphique : Selectra
En €/l
Ces taxes, ajustées périodiquement, jouent un rôle central dans la politique énergétique et environnementale.
Les changements profonds à l'aune du changement climatique
Face au changement climatique, les usages énergétiques évoluent profondément pour réduire les émissions de CO2 et limiter la dépendance aux énergies fossiles. Cette transformation s'accompagne d'une quête accrue d'indépendance vis-à-vis du réseau, grâce au développement des solutions locales et renouvelables.
Pompes à chaleur
Les pompes à chaleur (PAC) exploitent les calories présentes dans l’air (aérothermie) ou le sol (géothermie) pour chauffer ou refroidir les bâtiments, offrant une solution énergétique efficace et écologique. Elles consomment peu d’électricité et permettent de réduire significativement les factures énergétiques.
L’aérothermie, plus accessible et facile à installer, est idéale pour les logements existants, tandis que la géothermie, nécessitant des forages, convient mieux aux nouvelles constructions ou aux terrains adaptés. Ces technologies, subventionnées par des dispositifs comme MaPrimeRénov’, sont devenues un pilier de la transition énergétique en France.
Poêles et chaudières à bois
Le bois énergie, sous forme de poêles à bûches ou granulés et de chaudières, est une alternative renouvelable, locale et économique pour le chauffage des logements. Il est particulièrement attractif dans les zones rurales ou pour les ménages disposant d’un accès direct à cette ressource naturelle.
Les poêles (à bûches ou granulés) offrent un rendement élevé et une autonomie prolongée grâce à leur alimentation automatique, tandis que les chaudières à bois peuvent chauffer l’ensemble du logement et produire de l’eau chaude sanitaire.
Cependant, l’installation de ces systèmes doit répondre à des normes strictes pour limiter les émissions de particules fines. Des labels comme "Flamme Verte" garantissent leur performance environnementale.
Autoconsommation et batteries
L’autoconsommation permet de produire sa propre énergie grâce à des panneaux solaires photovoltaïques ou thermiques, voire des éoliennes domestiques, pour couvrir une partie ou la totalité de ses besoins.
Les batteries domestiques, comme celles de Tesla ou Enphase, stockent l’énergie produite en excédent pour une utilisation ultérieure, notamment la nuit ou en cas de pic de consommation.
Avec l’intégration des systèmes ERL (Émetteur Radio Linky), les foyers peuvent suivre en temps réel leur production et consommation énergétique, ajustant leur comportement pour maximiser les économies.
Bornes de recharge pour voitures électriques
Les bornes de recharge domestiques sont devenues incontournables avec l’essor des voitures électriques, permettant une recharge rapide et économique à domicile.
Les systèmes avancés, comme le "Vehicle-to-Grid" (V2G), permettent aux voitures de réinjecter de l’électricité sur le réseau ou de l’utiliser pour alimenter la maison. Les batteries des véhicules deviennent ainsi des outils de stockage énergétiques mobiles, renforçant la flexibilité du réseau.
Grâce à l’ERL des Linky, les propriétaires peuvent suivre la consommation liée à la recharge et adapter les heures de charge pour profiter des tarifs les plus bas.
Suivi des consommations énergétiques en ligne
Le suivi des consommations énergétiques via les espaces clients fournis par les fournisseurs et comparateurs, ou via des outils connectés au compteur Linky, permet d’identifier les appareils énergivores et de repérer les habitudes de consommation excessives, jour après jour.
En détectant les pics de consommation ou en optimisant l’utilisation des appareils électroménagers, ces solutions offrent un levier concret pour maîtriser son budget. Associées à des conseils personnalisés, elles renforcent la prise de conscience des ménages sur leurs usages énergétiques.
Isolation thermique des logements
L’isolation thermique des logements est un élément clé pour réduire les pertes énergétiques, améliorer le confort intérieur et diminuer les émissions liées.
En rénovation, les travaux d’isolation se concentrent sur les points les plus sensibles : murs, toitures, planchers et fenêtres, qui représentent souvent les principales sources de déperdition de chaleur.
Les maisons passives, quant à elles, incarnent l’excellence en matière d’isolation thermique. Conçues pour minimiser les besoins énergétiques, elles intègrent des matériaux isolants performants, des fenêtres à triple vitrage et des systèmes de ventilation à double flux. Grâce à ces technologies, elles maintiennent une température intérieure stable en utilisant un minimum d’énergie.
L’ADEME (Agence De l'Environnement et de Maîtrise de l’Énergie) est en charge de la mise en oeuvre des politiques de développement durable sur le territoire.