Production de Gaz Naturel : réserves, extraction, export
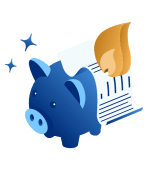
Souscrivez du gaz moins cher avec Selectra !
Réduisez vos factures et souscrivez une offre économique et adaptée à vos besoins

L'offre du moment à -15,5% (HT) par rapport au tarif réglementé
De l'électricité verte à prix fixe moins chère
Le gaz est produit en l'extrayant des gisements naturels d'où il provient, puis en le séparant de certains composants, avant de le transporter vers les pays importateurs. Alors que la Russie, l'Iran et le Qatar sont les pays qui ont le plus de réserves établies de gaz naturel, ce sont les États-Unis qui en produisent le plus, devant la Russie et l'Iran. Pour autant, la Russie, le Qatar et la Norvège sont les premiers exportateurs, alors que l'Allemagne, le Japon et la Chine sont les principaux importateurs.
Les étapes de la production du gaz naturel jusqu'à sa consommation
Formation des gisements de gaz naturel
Le gaz naturel que les hommes extraient des profondeurs est d'origine organique et s'est formé à partir de la décomposition de plancton et d'algues sur plusieurs millions d'années. La plupart des déchets organiques sont détruits et digérés par les bactéries. Une infime partie de la matière résiduelle (0,1%) se dépose toutefois au fond des océans (où elle est protégée de l'action des bactéries, car le milieu est trop pauvre en oxygène) et se mélange à des sédiments (sable, argile, sel).
Ce mélange forme une couche de boue qui durcit au fil des ans pour devenir de la "roche mère". Sous le poids des nouveaux sédiments qui s'y déposent, la roche mère s'enfonce très lentement dans la croûte terrestre : elle peut parcourir quelques mètres à quelques centaines de mètres par millions d'années. La pression et la température augmentent au fur et à mesure que la couche mère s'enfonce dans les profondeurs. La matière organique la composant se transforme en kérogène puis, à partir de 2000 mètres en dessous du niveau de la mer, en hydrocarbure (carbone et hydrogène) :
- Entre 2000 et 3800 mètres : le kérogène se transforme en pétrole ;
- Entre 3800 et 5000 mètres : les sédiments forment des hydrocarbures non plus liquides, mais gazeux : le gaz méthane (le plus léger des hydrocarbures) ;
- En dessous de 8000 mètres : on ne trouve plus d'hydrocarbures, car les températures très élevées les détruisent.
Les hydrocarbures remontent vers la surface de la terre, car ils sont plus légers que l'eau. Si rien ne les arrête, ils s'échappent et suintent à la surface de la terre ou se solidifient en bitume, perdant leur constituant volatil. S'ils rencontrent une couche imperméable, ils restent enfermés dans une poche qu'on appelle roche réservoir où la partie gazeuse remonte au-dessus du pétrole en repoussant vers le bas la nappe d'eau.
La sédimentation évolue en moyenne de 50 mètres par million d'années, il faut donc environ 60 millions d'années pour que le plancton mort se transforme en hydrocarbure liquide (pétrole) et 85 millions pour que se forme un hydrocarbure gazeux. On comprend dès lors pourquoi le pétrole ou le gaz naturel ne sont pas considérés comme des énergies renouvelables.
Exploration
La recherche de gaz naturel et l'estimation des volumes renfermés reposent sur la sismologie : des capteurs spéciaux sont mobilisés pour enregistrer des données relatives à la propagation d'ondes de choc artificielles, permettant d'obtenir des informations sur les structures géologiques en présence. Des cartographies du sous-sol sont établies à partir de ces données pour évaluer la présence de gaz naturel.
Plusieurs types de bassins apparaissent lors des explorations, on les différencie selon :
- Leur concentration d'hydrocarbure
- Les bassins prolifiques qui sont riches en hydrocarbures ;
- Les bassins stériles dont la concentration en hydrocarbures ne permet pas une exploitation rentable ;
- L'état d'avancement de leur exploitation :
- Il existe des bassins découverts depuis longtemps et qui ont déjà été forés à plusieurs reprises, ce sont les bassins matures dont l'exploitation continue, mais avec très peu de chance de rencontrer de nouveaux gisements géants ;
- Les bassins peu matures n'ont pas fait l'objet de nombreux forages et sont souvent privilégiés par les compagnies pétrolières ;
- Enfin, les bassins vierges ont été très peu exploités, voire jamais explorés à cause de la géographie qui les rend moins accessibles.
Extraction
Lorsque le gisement de gaz naturel est jugé suffisamment certain dans ses volumes et dans ses conditions économiques d'exploitation, les installations nécessaires à son exploitation peuvent être construites : puits d'extraction et gazoducs reliant les puits aux réseaux collecteurs. L'opération d'extraction consiste à faire remonter à la surface le gaz naturel enfermé dans le sous-sol, en creusant un trou, parfois jusqu'à 6 000 m de profondeur.
Des derricks de forage sont installés à la surface. il s'agit d'une tour métallique pouvant atteindre 30 mètres de haut qui permet d'insérer verticalement les tiges de forages. Généralement, le gaz naturel sortira des puits sans intervention extérieure du fait de la pression, mais certaines fois des équipements de pompage sont nécessaires.
Une fois le gaz extrait, la pression du circuit est ramenée à celle prévue pour le transport, avant injection du gaz dans le gazoduc de transport.
A noter que le gaz de schiste est un gaz naturel non conventionnel défini par son extraction des roches schisteuses par fracturation hydraulique. Si la France interdit son exploitation pour les pollutions et tremblements de terre qu'il pourrait causer, elle en importe des USA, qui est devenu le premier fournisseur de gaz naturel du pays en 2023.
Quelle est la durée de vie d'un gisement de gaz naturel ?
La durée de vie d'un gisement est varie en général de 15 à 30 ans et certains gisements gigantesques peuvent être exploités pendant 50 ans. Les gisements en mer profonde dont les coûts d'exploitations sont beaucoup plus élevés, ont une durée de vie d'entre 5 et 10 ans.
L'exploitation d'un gisement comprend 3 étapes :
- Les 3 premières années, les puits sont forés progressivement ce qui permet d'augmenter graduellement la production ;
- La production se stabilise : la durée de cette étape peut varier en fonction de la taille du bassin ;
- Enfin, une période de décroissance qui précédera la fermeture du site : pendant cette phase la production d'hydrocarbure baisse entre 1 et 10 % par an.
L'exploitation d'un gisement prend fin lorsque le coût d'extraction devient plus élevé que le bénéfice produit par la vente du gaz :
- Soit parce que l'eau résiduelle qui remonte avec l'hydrocarbure est de plus en plus importante et la séparation de l'eau (déshydratation) revient alors beaucoup trop chère ;
- Soit les procédés de récupération assistée sont trop coûteux pour continuer de manière rentable l'exploitation.
Les réserves ne sont jamais totalement épuisées, ainsi le taux de récupération de gisement de gaz atteint les 60 à 80 %. Celui-ci est relativement plus élevé que celui des gisements de pétrole, qui ne dépasse pas les 50 %.
Traitement
Le gaz obtenu doit être purifié pour devenir le gaz naturel que l'on consomme. Les installations de traitement peuvent être situées plus ou moins en amont de la chaîne de valeur, à proximité des lieux d'extraction du gaz naturel ou des zones de consommation. Ce traitement du gaz revient à le déshydrater par point de rosée et à séparer ses composants :
- Le gaz de pétrole liquéfié (GPL) comme butane ou propane ;
- Le dioxyde de carbone (CO2), séquestré ou transmis à un utilisateur industriel situé à proximité ;
- Le gaz acide vendu à l'industrie chimique ou séquestré,
- L'hélium, vendu s'il est présent en quantités suffisantes (ce qui permet de créer une source de revenus importante pour le gisement).
Le reste du gaz, qui représente la grande majorité du gaz naturel extrait et est essentiellement constitué de méthane (CH4), est injecté dans les réseaux de transport de gaz vers les lieux de consommation.
Les condensats du gaz naturel (récupérés à l'état liquide à la sortie du puits) et le gaz de pétrole liquéfié sont les deux produits disposant de la plus grande valeur marchande. Certaines exploitations gazières ne se sont montées que pour extraire ces produits, et réinjectent le reste du gaz naturel dans le gisement au lieu de l'exploiter commercialement.
Transport vers les pays importateurs
Après son extraction et son traitement, le gaz naturel doit être acheminé, ce qui représente une part importante de son prix final.

- Les gazoducs sont de grands canaux posés sur terre ou au fond des mers, pouvant relier les pays exportateurs et importateurs sur des milliers de kilomètres. Leur construction sur longue distance requiert de lourds investissements.
- Le transport par navire méthanier sous forme de gaz naturel liquéfié (GNL) est également très onéreuse, car elle nécessite la construction d'une usine de liquéfaction au point d'export, la construction d'une usine de regazéification près du point de consommation et la construction des navires spécialisés, les méthaniers.
C'est pourquoi les gisements de petite taille de gaz naturel éloignés des points de consommations ne sont pas forcément exploités. Faute d'infrastructures de transport adaptées, le gaz naturel issu des gisements de pétrole peut être brûlé sur place dans des torchères, au lieu d'être valorisé. Aujourd'hui, les préoccupations écologiques et la montée du prix de l'énergie incitent les acteurs du gaz à agir pour éviter ce recours aux torchères.
Notons enfin que le gaz naturel peut être stocké sous-terrainement, pour un usage ultérieur.
Les techniques alternatives de production de gaz naturel
Il est possible d'obtenir du gaz naturel autrement que par son extraction sous-terraine. Les différents gaz qui peuvent être transformés en gaz naturel ou en substituts utilisables comme tels sont :
- Gaz de méthane biologique (ou biométhane) : issu de la décomposition de matières organiques par méthanisation.
- Gaz de synthèse : produit à partir de procédés chimiques utilisant du charbon (gazéification), du pétrole, ou de la biomasse.
- Gaz de houille : provenant des veines de charbon dans les mines. Son exploitation est beaucoup plus ancienne : utilisé comme gaz d'éclairage jusqu'à la fin du XIXe siècle, il est issu de la transformation de la houille en coke.
- Hydrogène combiné à du CO₂ : peut être méthanisé pour produire du méthane synthétique utilisable comme gaz naturel.

Producteurs, exportateurs, importateurs : les principaux acteurs du marché du gaz
Ci-dessous peuvent être retrouvés :
Quels sont les principaux pays producteurs de gaz naturel ?
En une décennie, l'exploitation des gaz de schiste a permis aux USA de passer d'importateur net de gaz naturel à premier exportateur mondial.
Liste des plus grands pays producteurs de gaz dans le monde
Le graphique ci-dessous permet de comprendre quels sont les principaux pays producteurs de gaz naturel.
Classement des dix plus grands pays producteurs de gaz naturel en 2023
En milliards de mètres cubes de gaz naturel produit - Source : Enerdata - World Energy and Climate Statistics - Graphique : Selectra
milliards de mètres cubes
Le graphique montre que les pays ayant produit le plus de gaz naturel en 2022 étaient :
- Les États-Unis avec 1 027 milliards de mètres cubes de gaz naturel produits ;
- La Russie avec 699 milliards ;
- L'Iran avec 244 milliards;
- La Chine avec 219 milliards ;
- Le Canada avec 205 milliards ;
- Le Qatar avec 170 milliards ;
- L'Australie avec 162 milliards ;
- La Norvège avec 128 milliards ;
- L'Arabie Saoudite avec 105 milliards ;
- L'Algérie avec 102 milliards.
Quelles sont les principales entreprises productrices de gaz ?
Afin d'extraire le gaz, puis de le traiter, il existe des entreprises nommées les super-majors. Actrices importantes de la commercialisation des énergies fossiles, ces entreprises sont généralement spécialisées dans le gaz naturel ainsi que le pétrole.
- Saudi Amarco, en Arabie Saoudite ;
- Gazprom, en Russie ;
- PetroChina, en Chine ;
- ExxonMobil, société américaine ;
- Chevron, société américaine ;
- Shell, société néerlandaise et anglaise ;
- TotalEnergies, société française.
- Statoil, en Norvève ;
- Sonatrach en Algérie ;
- Socar en Azerbaïdjan.
Liste des plus grands pays producteurs de gaz en Europe
Pour connaitre les principaux producteurs de gaz naturel en Europe, il est possible de se référer au graphique ci-dessous.
Classement des principaux pays européens producteurs de gaz naturel en 2023
En milliards de mètres cubes de gaz naturel produit - Source : Statistical Review of World Energy 2024 - Graphique : Selectra
milliards de mètres cubes
| Production | |
|---|---|
| Norvège | 116.6 |
| Royaume-Uni | 34.5 |
| Ukraine | 17.7 |
| Pays-Bas | 9.9 |
| Roumanie | 8.9 |
| Allemagne | 3.8 |
| Pologne | 3.6 |
| Italie | 2.8 |
| Danemark | 1.4 |
En milliards de mètres cubes de gaz naturel produit - Source : Statistical Review of World Energy 2024 - Graphique : Selectra
Quels sont les principaux pays exportateurs de gaz naturel ?
La majorité des pays appartenant aux plus gros producteurs de gaz naturel font partie des plus gros pays exportateurs de gaz naturel. Cependant, certains pays très producteurs ne font pas partie des plus gros exportateurs. C'est le cas des États-Unis par exemple, qui, s'il produit beaucoup, conserve la majorité de sa production pour une consommation interne.
Liste des plus grands pays exportateurs de gaz dans le monde
La production de gaz ne signifie pas forcément l'exportation, bien que la majorité des grands producteurs de gaz naturel se retrouvent dans la liste des principaux pays exportateurs de gaz naturel. Pour plus de détails sur les principaux exportateurs de gaz naturel, il est possible de se référer au graphique ci-dessous :
Classement des cinq plus grands pays exportateurs de gaz naturel en 2021
En milliards de mètres cubes de gaz naturel exporté - Source : CIA World Factbook - Graphique : Selectra
milliards de mètres cubes
| Exportations | |
|---|---|
| Russie | 250.85 |
| États-Unis | 188.4 |
| Qatar | 126.75 |
| Norvège | 107.34 |
| Australie | 101.77 |
En milliards de mètres cubes de gaz naturel exporté - Source : CIA World Factbook - Graphique : Selectra
- La Russie avec 210,2 milliards de mètres cubes de gaz naturel exportés ;
- Le Qatar avec 126,5 milliards ;
- La Norvège avec 120,2 milliards ;
- Les États-Unis avec 89,6 milliards;
- Le Canada avec 83,9 milliards ;
- L'Australie avec 67,9 milliards ;
- L'Algérie avec 53,8 milliards ;
- Les Pays-Bas avec 51,2 milliards ;
- La Malaisie avec 38,2 milliards ;
- Le Turkménistan avec 38,1 milliards.
Liste des plus grands pays exportateurs de gaz en Europe
Quant aux pays Européens, il est possible de consulter le graphique ci-dessous, qui indique les principaux pays européens exportateurs de gaz naturel.
Classement des principaux pays européens exportateurs de gaz naturel en 2020
En milliards de mètres cubes de gaz naturel produit - Source : CIA World Factbook - Graphique : Selectra
milliards de mètres cubes
Finalement, les plus grands exportateurs de gaz en européens sont les pays suivants en 2020 :
- La Norvège avec 120,2 milliards de mètres cubes de gaz naturel exportés ;
- Les Pays-Bas avec 51,2 milliards ;
- L'Allemagne avec 34,6 milliards ;
- Le Royaume-Uni avec 11,2 milliards ;
- La France avec 6 milliards.
Notons que certains pays comme la France ne produisent pas, mais importent avant d'exporter, notamment vers l'Allemagne qui consomme beaucoup, ou vers la Suisse qui n'a pas d'accès maritime.
Quels sont les principaux pays importateurs de gaz naturel ?
S'il y a de nombreux pays exportateurs, à l'échelle mondiale et européenne, il y a donc également de nombreux pays importateurs, en demande de gaz naturel. Il est possible de découvrir quels sont ces pays dans les graphiques et listes suivantes.
Liste des plus grands pays importateurs de gaz dans le monde
Il existe de nombreux pays en demande de gaz naturel dans le monde, à qui exportent les pays mentionnés plus haut. Les principaux pays importateurs de gaz naturel dans le monde peuvent être observés ci-dessous :
Classement des cinq plus grands pays importateurs de gaz naturel en 2020
En milliards de mètres cubes de gaz naturel importé - Source : CIA World Factbook - Graphique : Selectra
milliards de mètres cubes
Le graphique précédent montre, qu'à l'échelle mondiale les pays suivants sont ceux importants le plus de gaz naturel depuis des pays extérieurs en 2020 :
- L'Allemagne avec 119 milliards de mètres cubes de gaz naturel importés ;
- Le Japon avec 116,5 milliards ;
- La Chine avec 97,6 milliards ;
- Les États-Unis avec 86 milliards ;
- L'Italie avec 69 milliards ;
- La Turquie avec 55 milliards ;
- Les Pays-Bas avec 51 milliards ;
- Le Mexique avec 50 milliards ;
- La Corée du Sud avec 48,6 milliards ;
- La France avec 48,5 milliards.
Il est possible de connaitre les pays les plus importateurs de gaz à l'échelle européenne. Les pays européens réalisant le plus d'importations de gaz naturel sont les suivants :
Classement des principaux pays européens importateurs de gaz naturel en 2020
En milliards de mètres cubes de gaz naturel produit - Source : CIA World Factbook - Graphique : Selectra
milliards de mètres cubes
Où se trouvent les réserves de gaz naturel dans le monde ?
Une réserve de gaz est considérée comme prouvée lorsqu'elle peut être exploitée de manière économiquement rentable avec les technologies actuelles et dans les conditions géopolitiques et commerciales existantes.
La Russie, qui représentait déjà 19,9 % des réserves mondiales en 2021, l'Iran qui représentait 17,1 %, et le Qatar qui représentait 13,1 %, sont trois pays les mieux dotés en gaz, concentrant à eux trois plus de la moitié des réserves prouvées de gaz naturel de la planète.
Réserves prouvées de gaz naturel dans le monde en 2022
Source : BP World Energy Outlook, 2022 - Graphique : Selectra
milliards de m3
Les réserves prouvées évoluent toutefois rapidement : par exemple, les États-Unis ont ainsi devancé l'Arabie Saoudite en réserves prouvées de gaz naturel suite au développement intense de l'extraction de gaz de schiste et des analyses des sols qui s'ensuivent.
D'où provient le gaz naturel consommé en France ?
Importé à 98%
La France importe quasiment la totalité du gaz naturel qu'elle consomme. En 2022, par exemple, elle a importé un total de 640 TWh PCS de gaz auprès de différents pays à l'international. Les importations de gaz naturel se répartissent comme suit dans le graphique ci-dessous :
Provenance des importations de gaz naturel de la France
Source : Ministère de la Transition Écologique - Graphique : Selectra
En % et en TWh au passage de la souris
À noter que 17 % du gaz importé a été acheté directement sur les marchés, rendant impossible la détermination de son origine.
Depuis 1973 et les débuts de l'importation du gaz en France, il peut être observé une certaine évolution : si la demande a été croissante et continue de l'être, la France s'est tournée vers différents acteurs au cours de ces dernières années pour son approvisionnement en gaz.
Par exemple, sa demande auprès de l'ensemble des pays a décru légèrement depuis 2020, excepté pour les États-Unis, qui ont justement commencé à commercialiser leur gaz à cette date.
Il est à noter également que les pays avec lesquels la France a toujours collaboré dans le cadre de ses importations de gaz naturel sont :
- Les Pays-Bas (depuis avant 1973) ;
- L'Algérie (depuis avant 1973) ;
- La Russie (depuis 1973) ;
- La Norvège (depuis 1976).
Il peut être remarqué que contrairement à certains autres pays européens, la France a su diversifier les acteurs lui exportant le gaz, évitant de la rendre dépendante d'un pays producteur, contrairement à l'Allemagne par exemple qui dépendait beaucoup du gaz russe avant la guerre en Ukraine en 2022.
Y a-t-il des exploitations de gaz naturel en France ?
La France possédait aussi son gisement de gaz naturel, à Lacq, dans le sud-ouest de la France. Ce gisement est arrivé en fin de vie en 2013, après une exploitation de 1957. Par la suite, a été lancé le projet de transformer le gisement de gaz en un pôle d'excellence en chimie fine et de spécialités, pour que ce bassin industriel trouve une reconversion, une manière d'assurer le maintien des emplois dans la région.
Alors que la France disposerait des principales ressources de gaz de schiste en Europe, son extraction a été interdite de 2011 par la loi Jacob. Le pays pourrait également décider d'extraire le gaz de houille, particulièrement en Lorraine, très riche en grisou. Le gaz de houille est présent dans des filons de charbon ; sa couleur noirâtre provient de la carbonisation d'organismes végétaux.
L'exploitation de ce gaz made in France serait créatrice d'emploi et facteur de compétitivité et productivité. Les défenseurs de l'environnement suggèrent toutefois plutôt d'investir dans les énergies renouvelables que dans les énergies fossiles.
Comment est envisagée la production de gaz naturel à l'avenir ?
Si les avis divergent beaucoup sur le temps d'exploitation du gaz naturel restant, la certitude est qu'il s'agit d'une ressource fossile et qu'elle devrait connaître un point où la production ne pourra que décliner en raison de l'arrivée à maturité des gisements de gaz et où son coût d'extraction s'avèrera moins compétitif que d'autres sources d'énergie. À rappeler cependant que le gaz naturel est une ressource plus abondante que le pétrole, et que ses gisements s'épuiseront moins rapidement.
'Agence Internationale de l'Energie (AIE) estime que les réserves prouvées de gaz naturel représentent 180 000 Gm3, correspondant à environ 60 ans de production de gaz naturel. BP Statistical Review évoquait 55 ans en 2018.
TotalEnergies estime qu'il reste encore 100 ans d'exploitation du gaz, mais inclut également les gaz non conventionnels, qui représenterait 45 % des 850 000 Gm3 de réserves récupérables à long terme.
Quel est l'impact du gaz naturel sur la géopolitique mondiale ?
Les pays producteurs de gaz naturel peuvent utiliser ce levier comme moyen de pression sur les autres pays mondiaux. Cela a notamment été le cas avec le conflit en Ukraine, où les livraisons de la part de la Russie ont drastiquement diminué, ou encore du Qatar, où la communauté internationale peine à sanctionner le pays pour son non respect aux droits humains du fait de sa production massive d'énergies fossiles.
Également, le transport du gaz par gazoduc traversant des pays politiquement instables, l’irruption de conflits peut faire peser un risque de pénurie.
Ce qui explique l'essor impressionnant du GNL ces dernières années, le transport par navires permettant de diversifier ses sources d'approvisionnement.
Quel est l'impact environnemental de la production de gaz naturel ?
Le gaz est l'un des combustibles fossiles les moins polluants. Dans l’idéal, c’est-à-dire si sa combustion est parfaite, il n’émet que de l’eau et du dioxyde de carbone. Cependant, l’extraction, le transport et la combustion du gaz, dans la réalité, provoquent d’importantes émissions de méthane. Or le méthane est un gaz à effet de serre majeur, considéré comme bien plus important que le dioxyde de carbone dans le changement climatique.
Dans le détail, l'extraction du gaz naturel est préjudiciable à l'environnement à plus d'un titre :
- Les infrastructures d'exploitation et de traitement des gisements d'hydrocarbures sont consommatrices d'énergie ;
- Le transport du gaz naturel génère d'importantes émissions de gaz à effet de serre. Les fuites de méthane, particulièrement puissant en matière d'effet de serre, peuvent être significatives sur les gazoducs. La liquéfaction du gaz naturel pour le transport par la filière du GNL entraîne de son côté de grandes consommations d'énergie et quelques pertes sur les volumes transportés ;
- L'extraction du gaz de schiste est accusée de provoquer une détérioration du paysage par la multiplication des têtes de forage, une pollution importante des sous-sols et des nappes phréatiques par des produits chimiques. La consommation d'eau dans le cadre de la technique de la fracturation hydraulique est également très importante.
Cependant, il existe en effet des alternatives au gaz naturel plus respectueuses de l’environnement. C’est le cas du biogaz, qui est issu de la fermentation de matières organiques. En somme, il s’agit d’une version renouvelable et non-fossile du gaz naturel. Ce gaz peut être utilisé pour les mêmes usages.

