Stockage du gaz en France : méthodes et niveau en février 2026
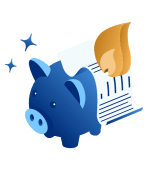
Souscrivez du gaz moins cher avec Selectra !
Réduisez vos factures et souscrivez une offre économique et adaptée à vos besoins

L'offre du moment à -15,5% (HT) par rapport au tarif réglementé
De l'électricité verte à prix fixe moins chère
Le niveau de remplissage des stocks de gaz français s'élève à 21,51% au 22/02/2026. Le stockage du gaz joue un rôle stratégique dans la sécurité énergétique, en permettant de répondre à des besoins variés allant des fluctuations saisonnières de la demande à la stabilisation des prix. Deux grandes méthodes existent : le stockage souterrain, qui utilise des formations géologiques comme les cavités salines, les nappes aquifères ou les gisements épuisés, et le stockage aérien, comprenant des réservoirs et des cuves de GNL. Ces infrastructures, gérées principalement par Storengy et Teréga en France, sont réparties sur le territoire pour garantir une efficacité optimale.
Où en est le stock de gaz en France aujourd'hui ?
26802 GWh sur une capacité totale de 124600 GWh, soit 21.51%
Le suivi des stocks de gaz est un enjeu stratégique majeur, tant pour le chauffage des ménages que la production industrielle. De plus, plus les stocks sont bas, plus le prix du gaz a tendance à augmenter.
Données à jour du 20/02/2026. Source : Terega et Storengy.
| PITS | Capacité | Remplissage | Taux |
|---|---|---|---|
| Storengy Centre | 45000 GWh | 9839 GWh | 21.86% |
| Storengy Sediane B | 6000 GWh | 1404 GWh | 23.4% |
| Storengy Serene | 15000 GWh | 2874 GWh | 19.16% |
| Storengy Sediane | 13500 GWh | 2130 GWh | 15.78% |
| Storengy Saline | 12000 GWh | 3846 GWh | 32.05% |
| Terega | 33100 GWh | 6710 GWh | 20.27% |
| Total | 124600 GWh | 26802 GWh | 21.51% |
Données à jour du 20/02/2026. Source : Terega et Storengy.
Capacités de stockage du gaz naturel en France
En France, deux opérateurs de stockage (Téréga et Storengy) gèrent un stock utile de 11,7 milliards de mètres cubes de gaz naturel (132 TWh), répartis en 16 sites, ce qui représente 36% de la consommation annuelle française en 2023, et 48% de sa consommation hivernale.
La France fait ainsi partie des pays européens qui disposent du plus grand stock de gaz naturel, en proportion de sa consommation annuelle.
| Opérateur de stockage | Capacités de stockage |
|---|---|
|
5 groupements de stockage, (14 sites) :
|
|
 |
1 groupement de stockage regroupant 2 sites :
|
Alors que le stockage du gaz dans des gisements épuisés représente les trois quarts des plus de 600 sites de stockage à travers le monde, la France n'en dispose que de deux. Cela s'explique notamment par le fait qu'elle ait disposé de peu de sites d'extraction de gaz par le passé. Le pays disposes de 10 sites de stockage du gaz en nappes aquifères et 4 en cavités salinières.
Lors de son arrivée par méthanier en France, le GNL est parfois stocké dans des réservoirs cryogéniques situés dans le terminal méthanier. Toutefois, ce type de stockage n’entre pas, en France, dans le calcul des capacités de stockage. Au total, les capacités de stockage de la France sont de 138,55 TWh, et de 2 376 GWh/jour de soutirage.
Risques de pénurie : les stocks seront-ils suffisants pour cet hiver ?
A l'heure actuelle, aucune alerte n'est prévue pour cet hiver. Les stocks actuels devraient être suffisants pour répondre à la consommation des particuliers et des entreprises. Même dans un cas de vague de froid, les stocks et la commercialisation du gaz avec les autres pays européens devraient permettre de pallier à des pics de consommation.
Le stockage n'est pas le seul levier dont la France bénéficie : une importation continue de gaz naturel liquéfié et les interconnexions gazières avec ses voisins européens peuvent aider à pallier une demande supérieure aux prévisions.
Preuve que la chaine de valeur de l'approvisionnement en gaz naturel en France est résistante, aucune coupure n'avait eu lieu lors de l'hiver 2022-2023, alors que la baisse des livraisons russes avait mis en tension tout le marché européen. La baisse des consommations avait aussi joué un rôle important.
Pour être averti des éventuelles tensions sur le réseau de gaz, il est possible de suivre Ecogaz, mis en place par l'ADEME, Teréga et GRTgaz.
| Date | 23/02 | 24/02 | 25/02 | 26/02 |
|---|---|---|---|---|
| Couleur du jour |
Source : NaTran, Teréga. Signal Ecogaz actualisé le 22/02/26


Comment stocke-t-on du gaz ?
Le gaz naturel peut-être stocké à l'état gazeux (à pression atmosphérique ambiante) ou à l'état liquéfié (GNL).
Le butane et le propane sont stockés dans des réservoirs sphériques pour une capacité totale stockée de 500 à 10 000 mètres cubes.
Le stockage souterrain
Le stockage souterrain est la méthode la plus répandue car il permet de stocker le gaz naturel en grandes quantités. Ce type de stockage exploite des formations géologiques situées à plusieurs centaines voire milliers de mètres sous la surface. Le gaz y est injecté sous pression pour être conservé jusqu’à son utilisation.
Des cavités souterraines aux caractéristiques géologiques appropriées permettent, une fois aménagées, d'enfermer de grandes quantités de gaz naturel, avec des investissements relativement limités en comparaison du stockage aérien.
Les sites appropriés au stockage souterrain du gaz sont :
- en cavité saline : les formations salifères localisées entre une couche supérieure et une couche inférieure de terrain imperméable. Il suffit alors d'injecter de l'eau pour dissoudre le sel et créer une cavité imperméable.
- en nappe aquifère : des roches poreuses gorgées d'eau et entourées par des roches imperméables.
- en gisement déplété : dans un ancien gisement de gaz naturel, épuisé et reconverti en unité de stockage du gaz.
Dans les cavités salines
Le stockage dans les cavités salines consiste à créer des espaces dans des dômes ou couches de sel par dissolution avec de l’eau, puis à y injecter le gaz. Ces cavités offrent une étanchéité naturelle, empêchant les fuites de gaz, et permettent surtout un cycle rapide d’injection et de soutirage, idéal pour les besoins à court terme ou les pics de consommation.
Dans les nappes aquifères
Les nappes aquifères sont des formations géologiques contenant de l'eau, que l'on utilise comme réservoirs pour le stockage de gaz. Le gaz y est injecté en remplaçant temporairement l’eau présente, sous pression, qui est poussée vers l'extérieur.
Ces nappes permettent de stocker de grandes quantités de gaz, souvent proches des zones de consommation, ce qui optimise la logistique. Cependant, les cycles de soutirage et d’injection sont plus lents que dans les cavités salines, ce qui limite leur flexibilité.
Dans les gisements épuisés
Le stockage dans les gisements épuisés consiste à réutiliser d’anciens réservoirs de gaz ou de pétrole. Ces formations, déjà utilisées pour contenir du gaz naturel pendant des millions d'années, sont naturellement adaptées au stockage, offrant de grandes capacités et une certaine sécurité.
Ces gisements sont souvent situés loin des centres de consommation, c'est pourquoi ils sont surtout par les pays producteurs et utilisés près de gisements toujours exploités.
Le stockage aérien
Le stockage aérien est une solution complémentaire au stockage souterrain, utilisée principalement pour des volumes plus modestes et une accessibilité rapide. Il est souvent utilisé pour des besoins industriels ou pour sécuriser l’approvisionnement en gaz dans des zones isolées.
Les infrastructures sont situées en surface, comme les réservoirs et les cuves de gaz naturel liquéfié.
Les réservoirs
Les réservoirs de stockage aérien sont des structures en acier ou en béton, souvent sous forme de sphères ou de cylindres, qui stockent le gaz sous forme compressée. Ils permettent une accessibilité immédiate et une flexibilité d’utilisation pour les besoins industriels et domestiques.
Cependant, ces réservoirs sont limités en capacité par rapport au stockage souterrain et occupent une surface importante. Ils nécessitent également des systèmes de sécurité avancés pour prévenir les fuites ou les explosions.
Les cuves de GNL
Les cuves de GNL permettent de stocker du gaz naturel sous forme liquéfiée à une température de -162°C, ce qui réduit son volume de 600 fois par rapport à son état gazeux.
Il se fait à proximité des terminaux méthaniers et des infrastructures de liquéfaction du gaz naturel, des réservoirs cylindriques verticaux de tous types sont utilisés (paroi simple ou double, enceinte métallique ou en béton, enterrés, semi-enterrés, posés au sol, ou sur pilotis).
Toutefois, des pertes de gaz peuvent survenir sous forme d’évaporation (boil-off), même avec des systèmes isolants avancés, ce qui peut limiter leur efficacité à long terme.
Où le gaz est-il stocké en France et par qui ?
La répartition géographique des zones de stockage permet d'optimiser le fonctionnement du réseau gazier.
Les zones de stockage
En France, le gaz est principalement stocké dans des sites souterrains répartis sur le territoire pour garantir la sécurité d'approvisionnement.
Ils sont stratégiquement localisés pour être proches des grandes zones de consommation et des principaux axes de transport de gaz. Par exemple, les installations de Céré-la-Ronde ou de Gournay-sur-Aronde assurent l'approvisionnement du nord de la France, tandis que celles de Beynes et Manosque répondent aux besoins du sud.

Le pays dispose d'une capacité totale d’environ 130 térawattheures, ce qui place la France parmi les leaders européens en termes de capacité de stockage souterrain.
Les acteurs : Storengy et Teréga
En France, deux principaux opérateurs gèrent les infrastructures de stockage souterrain : Storengy, filiale d’ENGIE, et Teréga, anciennement TIGF, qui opère dans le sud-ouest du pays.
- Storengy est de loin le principal acteur, exploitant 14 des 16 sites de stockage en France, pour une capacité totale d'environ 120 TWh.
- Teréga, quant à lui, gère les deux autres sites, situés dans la région Nouvelle-Aquitaine, avec une capacité de stockage de près de 10 TWh.
- Notons que les installations de Géométhane dans le sud-est de la France sont exploitées par Storengy.
La cadre réglementaire
Les opérateurs sont soumis à un cadre réglementaire strict, supervisé par la Commission de régulation de l'énergie (CRE).
Depuis 2018, un nouveau mécanisme de régulation garantit que les capacités de stockage sont utilisées de manière optimale (par le biais d'enchères publiques) et détermine les revenus autorisés. De plus, la loi impose aux fournisseurs de gaz naturel des obligations de remplissage minimal des capacités souscrites avant l'hiver de 85 % des capacités auxquelles ils ont souscrit au 1ᵉʳ novembre. Ce niveau peut être revu par le gouvernement selon les besoins, dans le cadre de la Planification Pluriannuelle de l'Energie (PPE).
La rémunération des opérateurs de stockage
La rémunération des opérateurs de stockage en France est encadrée par un mécanisme de régulation mis en place par la CRE. Les revenus des opérateurs proviennent principalement des enchères organisées pour allouer les capacités de stockage, un système introduit en 2018 pour garantir une utilisation efficace des infrastructures.
Ce modèle repose sur une rémunération stable pour les opérateurs, tout en incitant les acteurs du marché à optimiser leurs besoins. La régulation permet d'éviter une gestion basée sur l'optimisation des revenus, pour garantir plutôt la sécurité d'approvisionnement.
Ce mécanisme permet de couvrir les coûts d’exploitation, de maintenance et d’investissement des sites de stockage, tout en assurant une juste rémunération aux opérateurs. En 2023, le revenu total généré par les enchères pour les capacités de stockage en France a atteint environ 600 millions d’euros.
Les gestionnaires de stockage sont donc rémunérés selon le tarif d'Accès des Tiers au Stockage (ATS). Il représente environ 4 % du prix du gaz pour les foyers chauffés au gaz.
La sécurité des sites
Les sites de stockage doivent répondre à des normes rigoureuses en matière de surveillance, de maintenance et de prévention des risques, avec des inspections régulières menées par les autorités compétentes. En France, ces installations, sont souvent classées "SEVESO seuil haut".
Chaque site est équipé de systèmes de détection des fuites, de dispositifs de contrôle de pression et de plans d’urgence en cas d’incident. Ces mesures visent à minimiser tout risque pour l’environnement et les populations avoisinantes.
Les incidents sont rares, et lorsqu'ils surviennent, ils se produisent souvent au niveau des puits de stockage, où des opérations techniques complexes sont réalisées. Le gaz stocké en profondeur est coupé de tout contact avec l'oxygène de l'air, réduisant ainsi de manière importante les risques d'explosions, qu'elles soient accidentelles ou intentionnelles. De plus, une épaisse barrière sédimentaire située entre les installations souterraines et la surface offre une protection efficace contre les événements externes tels que les incendies, les intempéries, les attentats ou encore les chutes d'avions. Ce type de stockage présente également une grande résistance face aux séismes.
Pourquoi stocker du gaz ?
Contrairement à l’électricité qui ne peut être stockée en grande quantité, le gaz naturel peut se stocker en masse.
Le stockage du gaz en fait une énergie particulièrement intéressante pour réguler le déséquilibre entre une demande saisonnière d'énergie et un approvisionnement continu. Ils apportent ainsi une sécurité supplémentaire, en réduisant la dépendance du pays vis-à-vis des facteurs extérieurs.
L’approvisionnement en gaz naturel par des terminaux méthaniers et gazoducs est continu au cours de l’année. Aussi, afin d’assurer la satisfaction de la demande de gaz naturel qui est saisonnière, les expéditeurs de gaz naturel doivent remplir les stocks pendant l'été. En période creuse, les stockages sont remplis. En période de pointe, les stockages sont utilisés afin de satisfaire la demande très importante.
Près des zones de production
Le stockage du gaz près des zones de production est essentiel pour gérer efficacement les volumes extraits et leur transport. Lorsque la production dépasse la demande, notamment en période estivale, le gaz excédentaire est stocké pour éviter de saturer les réseaux de transport. Cela permet de réguler les flux et d'assurer une continuité dans l'exploitation des gisements sans pertes inutiles.
Il réduit également les coûts logistiques et les risques de perturbations lors du transport vers les zones de consommation. En cas de défaillance sur un réseau de transport ou de ralentissement de la production, ces stocks stratégiques permettent de maintenir un approvisionnement stable sans dépendre immédiatement des importations ou des infrastructures plus éloignées.
Garantir la consommation lors des pics de demande en hiver
Le stockage de gaz est indispensable pour faire face aux pics de consommation hivernaux, où la demande peut doubler voire tripler par rapport à l'été, principalement en raison du chauffage. Par exemple en France, nous consommons environ 290 TWh en hiver, contre 95 TWh en été. Ces stocks permettent de lisser les écarts saisonniers entre la production, souvent constante, et la demande, fortement fluctuante.
Ces réserves stratégiques, obligatoires avant l’hiver, assurent que les ménages et les industries puissent continuer à fonctionner normalement sans interruptions.
Garantir la stabilité des prix
Le stockage de gaz naturel contribue à limiter les fluctuations excessives des prix sur les marchés de gros. En stockant du gaz lorsqu’il est abondant et moins cher, notamment en été, il est possible de le réinjecter dans le réseau en hiver lorsque la demande augmente, évitant ainsi des hausses brutales de prix pour les consommateurs.
Cette gestion permet de lisser les coûts et offre une prévisibilité aux acteurs économiques.
Dans un contexte de volatilité accrue sur les marchés gaziers internationaux, notamment à cause de tensions géopolitiques, le stockage agit comme un tampon qui limite les impacts directs des hausses de prix mondiales sur le marché intérieur.
Réduire la dépendance gazière
Le stockage est un levier stratégique pour réduire la dépendance aux importations, notamment dans des périodes de tensions internationales. En France, les capacités de stockage permettent de constituer des réserves stratégiques capables de couvrir plusieurs mois de consommation, offrant ainsi une sécurité énergétique face aux interruptions potentielles d’approvisionnement, comme celles observées avec le gaz russe en 2022.
En réduisant la nécessité d'importer en urgence à des prix élevés, le stockage renforce également l'autonomie énergétique du pays. Cette indépendance partielle protège les consommateurs des variations brutales de prix.

