Transport du gaz : gazoduc/méthanier, réseaux NaTran/Teréga
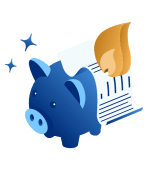
Souscrivez du gaz moins cher avec Selectra !
Réduisez vos factures et souscrivez une offre économique et adaptée à vos besoins

L'offre du moment à -15,5% (HT) par rapport au tarif réglementé
De l'électricité verte à prix fixe moins chère
Une fois extrait, le gaz naturel passe par un réseau de gazoducs ou est parfois liquéfié et déposé sur des navires méthaniers ; deux modes de transports semblables à des autoroutes qui acheminent cette énergie fossile jusqu'aux régions de consommation. Il parcourt alors de nouveau de grands canaux, qui en France sont gérés par deux entreprises : NaTran et Terega ; avant d'être distribué et finalement consommé.
GRTgaz change de nom et devient NaTran
Pour célébrer son 20e anniversaire, GRTgaz change d’identité et devient NaTran. Avec sa nouvelle signature, « le cœur de vos énergies », l’entreprise s’engage dans un projet ambitieux, NaTran2030, visant à placer ses infrastructures au centre du système gazier et à contribuer à l’objectif de neutralité carbone d’ici 2050. En savoir plus
Les méthodes et les procédés du transport du gaz
Entre son lieu d’extraction et son lieu de consommation, le gaz naturel doit être acheminé.
De son lieu d’extraction jusqu’à la région de consommation, le gaz naturel emprunte :
- Un gazoduc pour transiter par voie terrestre, via des canalisations sur longue distance.
- Ou un méthanier pour être transporté sous forme liquide (GNL) jusqu’en France.
Le transport du gaz naturel par gazoduc demeure prédominant à l'échelle mondiale. En 2023, les échanges internationaux de gaz naturel se sont élevés à environ 1 227 milliards de mètres cubes (Gm³), dont 697 Gm³ (environ 57 %) ont transité par gazoduc, tandis que 530 Gm³ (environ 43 %) ont été acheminés sous forme de GNL par méthanier.
En France, de son lieu d’arrivée jusqu’à son lieu de consommation, le gaz naturel est acheminé :
- Au moyen d’un réseau de transport sur de moyennes distances ;
- Et (éventuellement) à l’intérieur d’un bassin de consommation donné, via un réseau de distribution.
Par gazoduc
Le transport du gaz naturel par gazoduc repose sur un réseau de canalisations à haute pression, généralement entre 50 et 100 bars, pour assurer un débit constant sur de longues distances. Un gazoduc est fait de tubes d'acier mis bout à bout et soudés pour constituer une canalisation. À l'extérieur, un gazoduc est recouvert d'un isolant permettant de le protéger contre la corrosion. À l'intérieur, un gazoduc peut être recouvert d'un matériau permettant une meilleure circulation du gaz transporté ou une meilleure résistance à la corrosion.
Les gazoducs terrestres prennent la forme de canalisations enterrées à environ un mètre de profondeur, par souci esthétique. Toutefois, lorsque le sol est gelé (permafrost) ou que la zone est désertique, les gazoducs prennent la forme de canalisations posées sur le sol. Les gazoducs sous-marins sont de plus en plus nombreux, mais sont beaucoup plus onéreux à construire que les gazoducs terrestres.
Le gaz est comprimé à plusieurs points stratégiques à l’aide de stations de compression situées tout au long du gazoduc. Ces stations utilisent des turbines ou des moteurs pour augmenter la pression et compenser les pertes liées au frottement du gaz dans les tuyaux. Les gazoducs, souvent enterrés, sont construits à partir de matériaux résistants, comme l’acier, pour supporter les fortes pressions et éviter les fuites. Des systèmes de surveillance numérique permettent de détecter d’éventuelles anomalies ou fuites.

Le gazoduc de transport pourra également être ponctué de postes de livraison, qui permettent la sortie du gaz transporté dans le gazoduc vers des réseaux de distribution de gaz naturel ou vers des gros sites de consommation (grands comptes industriels).
Les gazoducs transfrontaliers nécessitent une coordination internationale et des accords géopolitiques, car ils traversent plusieurs pays pour connecter les gisements aux zones de consommation.
Par méthanier
Le transport du gaz naturel par méthanier repose sur la liquéfaction préalable du gaz naturel (GNL) pour réduire son volume d’environ 600 fois, facilitant son acheminement sur de longues distances. Le GNL, refroidi à -162°C, est stocké dans des cuves cryogéniques situées à bord des méthaniers, conçues pour maintenir cette température extrême tout au long du trajet.
Il existe deux principaux types de méthaniers : ceux équipés de cuves à membrane, où le GNL est stocké dans des réservoirs intégrés, et ceux équipés de cuves sphériques (type Moss). Ces navires disposent également de systèmes de propulsion spécifiques, parfois alimentés au GNL lui-même, pour minimiser l’évaporation naturelle du gaz durant le transport.
Une fois arrivé à destination, le méthanier décharge sa cargaison vers les terminaux méthaniers grâce à des bras de déchargement spécialisés, où le GNL est regazéifié pour être injecté dans les réseaux de transport nationaux.
L'arrivée sur le sol français
La France dispose de plusieurs points d'entrée physiques pour le gaz naturel, répartis entre interconnexions terrestres et terminaux méthaniers.
Interconnexions terrestres :
- Dunkerque : point d'atterrage du gazoduc sous-marin Franpipe en provenance de la Norvège.
- Taisnières : deux interconnexions avec le réseau belge.
- Obergailbach : interconnexion avec le réseau allemand.
- Oltingue : interconnexion avec le réseau suisse.
- Larrau et Biriatou : interconnexions avec le réseau espagnol.
Terminaux méthaniers :
- Montoir-de-Bretagne (Saint-Nazaire) : terminal sur la façade atlantique.
- Fos-sur-Mer : deux terminaux sur la côte méditerranéenne, Fos Tonkin et Fos Cavaou.
- Dunkerque : terminal méthanier sur la mer du Nord.
- Le Havre : terminal méthanier flottant (FSRU) Cape Ann, mis en service en 2023.
Ensuite, pour l'acheminement jusqu'aux consommateurs finaux se fait en deux niveaux : le transport puis la distribution. Le transport de gaz concerne l'acheminement à haute pression sur de longues distances via des réseaux de gazoducs, tandis que la distribution de gaz se concentre sur la livraison à basse pression depuis les réseaux locaux jusqu'aux consommateurs finaux.

On distingue ainsi :
- Les gazoducs de collecte permettent d'acheminer le gaz naturel issu des sites d'extraction ou de stockage vers les sites de traitement du gaz ;
- Les gazoducs de transport (haute pression) permettent d'acheminé du gaz traité (prêt à la consommation) aux portes des grandes zones de consommation de gaz naturel (zones industrielles, villes) ;
- Les gazoducs de distribution (basse pression) acheminent le gaz au sein des zones de consommation pour arriver sur les sites clients.
Les transporteurs de gaz en France
Alors que le réseau de transport d’électricité français est géré par un unique gestionnaire de réseau de transport, le réseau de transport de gaz français est, quant à lui, géré par deux Gestionnaires de Réseau de Transport (GRT) différents. Cela s'explique par l'exploitation ancienne d'un gisement de gaz naturel dans le sud-ouest de la France.
| Région | Gestionnaire | Part du Réseau Français |
|---|---|---|
| Quart Sud-Ouest de la France |
| 16 % + 2 sites de stockage |
| Reste du territoire | 
| 84 % + de nombreux sites de stockage |
Dans les années 1950, un gisement de gaz naturel est découvert en France à Lacq, dans les Pyrénées-Atlantiques. Son exploitation est confiée à Gaz du Sud-Ouest (GSO). La société est également chargée de transporter le gaz dans le Sud-Ouest de la France. En complément, une Compagnie française du méthane (CFM) est créée afin de transporter le gaz issu du gisement de Lacq hors du quart sud-ouest de la France.
Au début de la décennie 2000, la CFM et GSO appartenaient respectivement à GDF et à Total. La séparation des tâches de production, transport, distribution et fourniture en vue de préparer l'ouverture à la concurrence en France a été actée et, sous l’égide de la Commission de régulation de l’énergie, il a été convenu le 17 octobre 2004 que Total transférerait ses parts de la CFM à GDF, tandis que GDF transférerait la propriété de GSO à Total. Il a résulté de cet échange la fusion, au 1er janvier 2005 :
- Des zones CFM Ouest et GDF Ouest en une zone GRTgaz Ouest ;
- Des zones CFM Centre et GDF Sud en une zone GRTgaz Sud ;
- La zone GSO est devenue la zone TIGF.
NaTran (ex-GRTgaz) : le principal transporteur de gaz français

NaTran est une filiale détenue à environ 61 % par le groupe ENGIE et à 39 % par la Société d'infrastructures gazières (SIG), un consortium public regroupant CNP Assurances, CDC Infrastructure et la Caisse des dépôts et des consignations.
NaTran a la gestion :
- d'un réseau principal long de près de 8 000 km, constitué de canalisations pouvant atteindre la largeur de 1,2 mètre, et dont la carte correspond à celle du réseau d'autoroutes ;
- d'un réseau régional long de 25 000 km, qui a pour fonction d'alimenter directement les réseaux de distribution et les clients industriels, et donc la carte correspond à celle du réseau de routes nationales et départementales.
En janvier 2025, GRTgaz devient NaTran pour marquer son engagement dans la transition énergétique. Le nom NaTran porte une signification forte. Il reflète le rôle de l’entreprise en tant qu’opérateur de TRANsport, sa volonté de TRANsformation, ainsi que son engagement sociétal en faveur de la NATure et de la TRANsition énergétique. GRTgaz a posé les bases de la transition gazière, et NaTran affirme son rôle central dans le développement des infrastructures de la transition énergétique, qui assureront le transport des molécules décarbonées telles que les gaz renouvelables, l’hydrogène et le CO₂.
- D'ici à 2030, NaTran s’engage autour de 5 objectifs stratégiques majeurs :
- Consacrer plus de 50 % de ses investissements annuels à la transition énergétique
- Multiplier par cinq la part des gaz renouvelables dans les réseaux
- Développer plus de 1 000 km de réseaux dédiés à l’hydrogène et au CO₂ en Europe
- Réduire son empreinte carbone de 40 %
- Attirer et renforcer les compétences essentielles à sa transformation
Teréga (ex-TIGF), le transporteur dans le quart Sud-Ouest de la France
Teréga exploite 16 % du réseau français de gazoducs, soit un réseau de près de 5 000 km, et gère 24 % des capacités nationales de stockage de gaz, dont les sites de Lussagnet (Landes) et Izaute (Gers).

L'entreprise gère le réseau de transport du gaz naturel dans le quart sud-ouest de la France. TIGF est l'héritière des grandes heures de l'exploitation du gisement gazier de Lacq (Pyrénées-Atlantiques). Situé dans le département des Pyrénées-Atlantiques en Aquitaine, ce gisement a été exploité jusqu'à 2013, date de son épuisement. A ses débuts, l'exploitation du gisement de Lacq était confiée à la Société Nationale de Gaz du Sud-Ouest, filiale d'Elf et de Gaz de France (GDF). Cette organisation a repris la suite de la Régie Autonome des Pétroles qui exerçait depuis 1939 les activités de prospection du gaz naturel en France. En 2000, Elf a fusionné avec Total. C'est donc Total et GDF qui co-détenaient la Société Nationale de Gaz du Sud-Ouest.
Ce réseau, dans le sous-sol béarnais, permet d'acheminer le gaz naturel en provenance de terminaux méthaniers, de gazoducs, ou de sites de stockage (comme le site géologique de stockage de Lussagnet, dans les Landes) jusqu'aux bassins de consommation. Ses "autoroutes" du gaz naturel sont enfouies à 1,2 m dans la terre. Elles irriguent 15 départements de Bordeaux à Perpignan.
Filiale de Total jusqu’en 2013, l’entreprise a été cédée à un consortium regroupant la Snam (acteur du transport du gaz naturel en Italie), EDF et GIC (Government of Singapore Investment Corporation, fonds souverain de Singapour), parts modifiées en 2018 avec l'entrée de Predica (filiale du Crédit Agricole) à hauteur de 10 %.
En 2018, TIGF a changé de nom pour devenir Teréga (TErritoires - REseaux - GAz).
Les missions des transporteurs de gaz
GRTgaz garantit l'équilibre global du système en assurant la gestion des flux entre les entrées et les sorties de gaz, tout en remplissant des missions de service public pour garantir la continuité du transport de gaz naturel, même en période de grand froid. La législation française impose en effet que le réseau puisse répondre aux pics de demande des consommateurs, y compris en cas de froid exceptionnel.
Unification des points d'échanges
Chaque fournisseur de gaz naturel doit assurer un équilibre journalier entre ses injections et les soutirages de ses clients. Jusqu'en 2018, il fallait prendre en compte l'injection en fonction de la zone d'équilibrage, ainsi injecter son gaz à Fos-sur-Mer et le consommer à Paris nécessitait le transfert d'une zone à une autre.
Pour faciliter les échanges, les zones d’équilibrage du réseau de transport de gaz français se sont progressivement réduites en nombre. Alors qu’il existait 8 zones d’équilibrage au 1er janvier 2003, il n’en existait plus que 3 au 1er janvier 2009 et une seule en novembre 2018.
- Le 1er janvier 2005, les zones GDF Ouest et CFM Ouest ont en effet fusionné en une zone GRTgaz Ouest tandis que la zone GDF Sud fusionnait avec la zone CFM Centre pour créer une zone GRTgaz Sud ;
- Puis, le 1er janvier 2009, les trois zones d’équilibrage du nord (GRTgaz Ouest, GRTgaz est et GRTgaz Nord) ont fusionné et créé une zone GRTgaz Nord.
- Enfin, le 1er Novembre 2018 vit naître la Trading Region France, avec son unique Point d'Echange de Gaz. Les zones Grtgaz Nord et GRTgaz Sud fusionnent, tandis qu'une collaboration renforcée est organisée entre GRTgaz et Teréga.
Il n'existe donc plus qu'une zone d'échange de gaz en France : elle s'appelle Trading Region France, et est composée d'un unique marché virtuel nommé Point d'Échange Gaz. Les deux transporteurs, Teréga et GRTgaz partagent l'organisation de ce marché unifié.
La fusion des trois zones du Nord a été bénéfique puisqu’elle a rendu le marché de gros du gaz naturel sur cette zone plus attractif. En 2011, 90% des échanges de gaz naturel aux points d’échange gaz (PEG) en France ont été réalisés sur le PEG Nord. La fusion en une seule zone d'échange pour toute la France permet de faciliter d'autant plus l'échange de gaz naturel et permet d'améliorer l'interconnexion Européenne en diversifiant les sources de gaz naturel.
Ce rapprochement a été possible grâce à l’augmentation des capacités d’échange entre le nord et le sud, essentiellement financées par GRTgaz. Les zones Teréga et GRTgaz se sont grandement rapprochées, et les acteurs collaborent ainsi mains dans la main pour la gestion du réseau.

Autre contrainte qui a disparu : la nature du gaz. En effet, le gaz naturel de certaines régions du nord de la France ne possédait pas exactement les mêmes caractéristiques que le gaz du sud, notamment à cause de la provenance du gaz. Le gaz du nord se nomme Gaz B, pour Bas pouvoir calorifique, tandis que le reste de la France est fournie en Gaz H, pour Haut pouvoir calorifique. Ils nécessitaient donc deux types de réseaux légèrement différents, avec des pressions différentes et une facturation adaptée.
Les clients
À cela s'ajoutent plusieurs obligations à l'égard de leurs différents clients, détaillées ci-dessous :
- vis-à-vis des clients du réseau de distribution particuliers et professionnels : veiller en toutes circonstances à la continuité de l'approvisionnement, notamment lors des pics de consommation en cas d'hiver très rigoureux ;
- vis-à-vis des clients industriels (connectés directement au réseau de transport) : acheminer le gaz naturel jusqu’aux clients industriels et aux distributions publiques, dans des conditions de coûts et de sécurité optimales ;
- vis-à-vis des expéditeurs de gaz (qui injectent le gaz sur le réseau) : offrir un accès au réseau de transport à tous les expéditeurs de gaz naturel agréés, en toute transparence, mais avec confidentialité et sans discrimination.
Sécurité
En France, les gazoducs sont signalés en surface par des bornes et balises jaunes, tandis qu'une bande de servitude de 5 à 20 mètres de large, où la végétation haute et les constructions sont interdites, indique leur présence, notamment en forêt. Dans les zones boisées, leur tracé est visible sous forme de corridors dépourvus d'arbres de grande hauteur.
Le gaz naturel n'est pas d'odeur. Cependant, pour des raisons de sécurité, les transporteurs de gaz sont en charge de l'odorisation.
Rémunération
L'ATRT (Accès des Tiers au Réseau de Transport) est un tarif d'accès fixé par la Commission de Régulation de l'Énergie, qui définit la méthodologie de calcul. Il a pour objectif de couvrir l'intégralité des coûts des gestionnaires de réseau, incluant les charges d'exploitation et de capital. Il est conçu pour inciter les gestionnaires à optimiser leurs coûts et améliorer continuellement la qualité de leurs services, en s'appuyant sur une gestion rigoureuse et efficace des réseaux.
Les tarifs de l'ATRT sont définis pour une période tarifaire de 4 ans, sur la base de prévisions de charges et de produits pour toute la période. En cas d'écart entre ces prévisions et les charges réelles, le mécanisme de CRCP (Compte de Régulation des Charges et Produits) permet de réajuster les tarifs. Par exemple, en juillet 2024, ce mécanisme a contribué à expliquer environ 20 % de la hausse de 27,5 % de l'ATRD de GRDF, principalement liée à une correction de l'inflation et à un manque à gagner durant la période précédente (ATRD6).
L'avenir du transport du gaz naturel
Les investissements dans le gaz devraient s'accroître dans les prochaines années. Avec le développement de la filière de biogaz française notamment, c'est tout l'acheminement de cette énergie qui va être repensé.
Développement du biométhane
Le biométhane est un gaz produit par la transformation des matières organiques. Ces dernières sont issues de divers secteurs : agriculture, industrie, déchets de restauration, déchets de collectivité, installations de stockage des déchets non dangereux. La digestion des déchets crée d'un côté un biogaz, dont les usages sont les mêmes que ceux du gaz naturel, d'un autre côté, le digestat, un engrais organique naturel.
Le premier poste de raccordement de biométhane au réseau de transport français a été mis en service à Chagny (Saône-et-Loire) en 2015. Plus de 70 sont raccordés aujourd'hui.
Baisse de la consommation
La forte baisse de la consommation de gaz en France, estimée à environ 30 % d'ici à 2035, pourrait entraîner une sous-utilisation des infrastructures gazières, augmentant ainsi les coûts fixes par unité de gaz transportée. Cette situation risque de se traduire par une hausse des tarifs pour les consommateurs restants, afin de compenser les investissements et les frais d'entretien des réseaux.
Adaptation à l'hydrogène
L'adaptation des canalisations de gaz à l'hydrogène consiste à modifier les infrastructures existantes pour permettre le transport sécurisé de ce gaz, dont les propriétés diffèrent de celles du gaz naturel. Cela inclut le renforcement ou le remplacement de certains matériaux des canalisations, car l'hydrogène, en raison de sa petite taille moléculaire, peut provoquer un phénomène de fragilisation des métaux, entraînant des risques de fuites.
Les systèmes de compression et de contrôle de pression doivent également être adaptés, car l'hydrogène nécessite des pressions plus élevées pour atteindre les mêmes performances énergétiques que le gaz naturel. Enfin, des systèmes de détection de fuites plus sensibles doivent être mis en place pour garantir la sécurité, et les infrastructures doivent être certifiées pour répondre aux normes spécifiques du transport d’hydrogène.
Cette transition est essentielle pour intégrer l'hydrogène comme énergie clé dans la décarbonation. Toutefois, l'adaptation des infrastructures pour accueillir des gaz renouvelables, tant pour le biogaz que l'hydrogène, nécessitera des investissements supplémentaires.
Considérations géopolitiques
Les gazoducs internationaux établissent une interdépendance entre les pays producteurs de gaz naturel et les pays consommateurs. En effet, un pays producteur entrera dans une relation de dépendance par rapport à son acheteur s'il ne dispose que d'un débouché d'exportation matérialisé par un gazoduc. Réciproquement, le pays acheteur est dépendant des volumes de gaz fournis par le pays producteur s'il n'a pas diversifié les routes des gazoducs entrants sur son territoire. Les pays de transit, qui voient passer les gazoducs sur leur territoire, peuvent également se servir des gazoducs comme d'un levier pour exercer une pression politique sur les pays producteurs et sur les pays destinataires.
Les gazoducs traversant l'Ukraine sont historiquement essentiels pour acheminer le gaz russe vers le Vieux Continent. En réponse aux sanctions occidentales à l'invasion russe en Ukraine, le Kremlin a imposé des coupes volontaires dans ses livraisons de gaz, accentuant la crise énergétique européenne, tandis que la destruction partielle des gazoducs Nord Stream en 2022 a marqué un tournant dans la fragilité des infrastructures stratégiques. Ces événements ont poussé les pays européens à accélérer la diversification de leurs approvisionnements, notamment en augmentant massivement les importations de gaz naturel liquéfié (GNL) par méthaniers, tout en réduisant leur dépendance au gaz russe.
La chaîne du gaz naturel liquéfié présente, en effet, moins cette relation d'interdépendance entre producteurs et consommateurs : les méthaniers peuvent choisir des routes différentes, et une rupture d'approvisionnement en provenance d'un pays producteur X peut facilement être compensé par l'ouverture d'une nouvelle route en provenance d'un pays producteur Y.
Bien que le transport de GNL ait connu une croissance notable ces dernières années, notamment en raison de la diversification des sources d'approvisionnement et des tensions géopolitiques, les gazoducs restent le mode de transport dominant pour le gaz naturel.
Lacq 2030
Le gisement de Lacq est un autre enjeu du transport du gaz. Ce gisement du sud-ouest de la France est à ce jour pratiquement épuisé. Il fallait donc penser à une reconversion du site pour éviter des destructions d'emplois soudaines à la fermeture du site. Total, SOBEGI (une filiale de Total et d'Engie) et Arkema, les exploitants du site, ont lancé en 2012 le projet Lacq Cluster Chimie 2030. Le but du projet est de prolonger l'extraction du gaz de Lacq, pour alimenter les acteurs de la plate-forme industrielle de Lacq, conçue comme un pôle d'excellence en matière de chimie.

