Le marché du gaz naturel en France : fonctionnement & chiffres
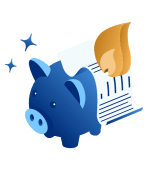
Souscrivez du gaz moins cher avec Selectra !
Réduisez vos factures et souscrivez une offre économique et adaptée à vos besoins

L'offre du moment à -15,5% (HT) par rapport au tarif réglementé
De l'électricité verte à prix fixe moins chère
Le marché du gaz naturel en France repose sur une infrastructure qui assure à la fois l’approvisionnement, la compétitivité et la sécurité énergétique du pays. Structuré autour d’un marché de détail ouvert à la concurrence et d’un marché de gros organisé en contrats à terme et en transactions SPOT, il permet aux fournisseurs d’optimiser leur approvisionnement en fonction de la demande et des fluctuations des prix. L’approvisionnement repose sur une chaîne de valeur diversifiée, incluant la production, l’importation via des interconnexions et terminaux méthaniers, ainsi que le transport et le stockage, qui jouent un rôle clé dans l’équilibre du réseau.
Le gaz naturel en France en données clés
Début 2025, les dernières données accessibles valaient pour l'année 2023. Elles sont résumées ci-dessous :
- Importations : 532 TWh, dont 59% via méthaniers et 41% via gazoducs.
- Les USA, la Norvège et la Russie sont les pays qui nous livrent le plus de gaz.
- Production domestique : 0,2 TWh de gaz naturel et 9 TWh de biométhane.
- Consommation corrigée des variations climatiques : 417 TWh, soit -11,4 % par rapport à 2022.
- Consommateurs : on dénombre 11 millions de compteurs de gaz.
- Exportations : 156 TWh.
- 7 interconnexions gazières (gazoducs) à nos frontières et 5 unités de regazéification du GNL en port maritime, dont 1 flottant.
- Longueur du réseau de transport de gaz naturel : +37 500 kilomètres.
- Longueur du réseau de distribution de gaz naturel : +195 000 kilomètres.
- Nombre de communes reliées au réseau de gaz naturel : +9 500.
- Part des français pouvant avoir accès au réseau de distribution de gaz naturel : 77%.
- Part du gaz naturel dans la consommation totale d'énergie en France : 15,5%.
Le mix énergétique français en %
Graphique : Selectra - Source : Chiffres clés de l'énergie - Édition 2023 - Ministère de la Transition Énergétique
%
Le marché de détail du gaz en France
Les particuliers et les entreprises sont les consommateurs finaux de gaz et s'approvisionnent sur le marché de détail du gaz naturel auprès des fournisseurs d'énergie.
Un marché ouvert à la concurrence
Le processus d'ouverture à la concurrence initié par la Commission européenne à la fin des années 1990 a abouti en juillet 2007 au libre choix du fournisseur de gaz naturel pour l'ensemble des consommateurs français de gaz naturel. La libéralisation s'est faite progressivement :
- Août 2000 pour les producteurs d'électricité et les entreprises consommant plus de 237 GWh de gaz naturel par an ;
- Août 2003 pour toutes les entreprises consommant plus de 83 GWh ;
- Juillet 2004 pour toutes les entreprises et toutes les collectivités locales ;
- Juillet 2007 pour tous les particuliers.
La libéralisation s'est poursuivie avec la disparition progressive des tarifs réglementés du gaz :
- Juin 2014 pour les entreprises directement raccordées au réseau de transport et celles dont la consommation est supérieure à 100 GWh/an ;
- Janvier 2015 pour les entreprises et les syndicats de copropriété dont la consommation annuelle est supérieure à 200 MWh/an ;
- Janvier 2016 pour les entreprises dont la consommation est supérieure à 30 MWh/an et les syndicats de copropriété dont la consommation est supérieure à 150 MWh ;
- Juillet 2023 pour toutes les entreprises et tous les particuliers.
Parts de marché
Le fournisseur historique de gaz naturel ENGIE dispose toujours de plus de la moitié des parts de marché pour les particuliers, et autour du tiers pour les professionnels. Le principal fournisseur alternatif de gaz naturel est un certain EDF, qui tire bénéfice de son statut historique sur le marché de l'électricité pour capter des clients ayant aussi le gaz naturel chez eux.
Parts de marché des principaux fournisseurs de gaz en France
Parts de marché des principaux fournisseurs de gaz en France métropolitaine sur le segment résidentiel - À jour en décembre 2024 - Source : CRE
Nb de compteurs résidentiels
Pourtant, changer de fournisseur de gaz est gratuit et les économies peuvent être conséquentes, et cela pour la même énergie, le même compteur et la même qualité de service pour les dépannages.
Le marché de gros du gaz naturel en France
Les professionnels du gaz s'échangent le gaz naturel sur le marché de gros du gaz, qui sont segmentés en deux catégories de marché : le marché à terme et le marché SPOT.

Sa structure est similaire à celle du marché de gros de l'électricité.
Le marché à terme : une sécurisation de l’approvisionnement via des contrats long terme
Le marché à terme concerne les livraisons de gaz naturel à long terme, c'est-à-dire dans les semaines, mois ou années après la conclusion du contrat.
Les contrats de long terme ont pour principal avantage de procurer une grande visibilité à l'acheteur (qui a besoin d'une certaine prévisibilité des volumes d'approvisionnement et de leurs prix) comme au vendeur (qui a besoin de s'assurer de débouchés pour réaliser les lourds investissements demandés par l'extraction et le transport du gaz naturel).
On distingue les contrats futures des contrats forwards.
Les contrats “futures” : des échanges standardisés sur les bourses
Les contrats futures sont négociés sur des bourses d’échange (EEX en France), où les parties s’engagent à acheter ou vendre une quantité prédéfinie de gaz à une date future et à un prix fixé à l’avance. Ces contrats sont standardisés en termes de quantité, date et lieu de livraison, ce qui facilite leur échange et leur liquidité sur les marchés financiers.
Les contrats forwards : des accords personnalisés en gré-à-gré
À l’inverse, les contrats forwards, également appelés « OTC » pour le sigle anglais « Over The Counter », sont négociés directement entre deux parties sans intermédiaire boursier.
Ils offrent une plus grande flexibilité dans la fixation des conditions du contrat (quantité, durée, prix, modalités de livraison), mais exposent aussi à un risque de contreparties plus élevé, puisqu’ils reposent sur la solvabilité et la fiabilité des signataires. Ils sont souvent passés sur le mode du take or pay (l'acheteur supporte le risque de volume).
Le marché de gré à gré du gaz naturel représente la grande majorité des volumes de gaz échangés sur le marché de gros en Europe. Ils sont principalement passés entre les grands opérateurs de gaz naturel (comme Engie ou ENI) et les grands producteurs de gaz naturel (comme Gazprom).
Le marché SPOT : un approvisionnement réactif pour les besoins de court terme
L'ouverture à la concurrence des marchés du gaz s'est concrétisée par l'émergence progressive des marchés organisés du gaz en Europe. Il s'agit de bourses de l'énergie sur lesquelles les professionnels s'échangent du gaz naturel sur le marché au comptant ou sur le marché à terme.
Ces marchés ne sont le plus souvent utilisés qu'à la marge par les fournisseurs de gaz pour ajuster leurs approvisionnements aux besoins de leurs clients. En effet, la volatilité des prix ne permet pas aux acteurs du marché de disposer d'une visibilité sur leurs coûts d'approvisionnement.
Les transactions sur ce marché concernent des livraisons immédiates ou à très court terme, avec différents produits :
- Day-ahead : transactions effectuées pour une livraison le lendemain ;
- Intraday : transactions réalisées 1 heure et 5 minutes avant la livraison ;
- Week-end : transactions réalisées le jeudi pour une livraison les samedi et dimanche qui suivent.
Le marché journalier (Day-ahead) : anticiper les ajustements à J-1
Le Day-ahead permet d’ajuster l’approvisionnement pour le lendemain afin de couvrir une hausse soudaine de la demande (par exemple en cas de vague de froid) ou de compenser une livraison non perçue (méthanier en retard ou livraison abaissée pour des raisons techniques ou géopolitiques).
Le marché infra-journalier (Intraday) : une flexibilité continue
Le marché Intraday permet de négocier en temps réel les prix d’achat et de vente tout au long de la journée, en ajustant les volumes de gaz disponibles aux besoins effectifs des consommateurs.
Le PEG
En France, la bourse du gaz s'appelle PEG, pour Point d'échange de gaz (PEG). Elle regroupe à la fois les échanges SPOT et les échanges à terme futures.
Le prix PEG est le prix de référence du gaz en France, à l'instar du TTF pour les Pays-Bas (et généralement pour l'Europe entière) et correspond au prix du gaz pour différentes échéances à venir.
La chaîne de valeur du gaz naturel
La chaîne du gaz naturel inclut, de l'amont à l'aval, les infrastructures suivantes :
- les installations d'extraction du gaz naturel au niveau des gisements de gaz ;
- les usines de traitement du gaz naturel, permettant de séparer les composants du gaz naturel pour les orienter vers les canaux de transport et de distribution appropriés ;
- les réseaux de transport de gaz naturel (gazoducs de transport et méthaniers sur longue distance) ;
- les infrastructures de stockage du gaz naturel (en aérien ou en souterrain) ;
- les réseaux de distribution du gaz naturel (gazoducs de proximité, permettant la desserte du consommateur final).

La production de gaz naturel
La production de gaz naturel en France est quasiment inexistante : le pays ne possède plus de gisements majeurs actifs pour la consommation des particuliers. Si dans les années 1970, la production nationale de gaz naturel tournait autour de 80 TWh par an, notamment grâce au gisement de Lacq dans le sud-ouest ; elle est désormais considérablement réduite.
La France produit encore quelques megawattheures de gaz naturel en Aquitaine et en Ile-de-France.
Elle produit également de plus en plus de biométhane, afin de réduire sa dépendance gazière et sa balance énergétique.
Évolution de la production de biométhane par trimestre en France
Données relevées en août 2025 - Graphique: Selectra - Source: Ministère de la Transition Écologique (SDES)
Les réserves de gaz représentent les volumes exploitables identifiés, la production de gaz correspond à l'extraction et au traitement du gaz naturel pour la consommation, tandis que l'exportation de gaz désigne la vente du gaz produit vers d'autres pays.
Réserves prouvées de gaz naturel dans le monde en 2022
Source : BP World Energy Outlook, 2022 - Graphique : Selectra
milliards de m3
Classement des dix plus grands pays producteurs de gaz naturel en 2023
En milliards de mètres cubes de gaz naturel produit - Source : Enerdata - World Energy and Climate Statistics - Graphique : Selectra
milliards de mètres cubes
Classement des cinq plus grands pays exportateurs de gaz naturel en 2021
En milliards de mètres cubes de gaz naturel exporté - Source : CIA World Factbook - Graphique : Selectra
milliards de mètres cubes
La Norvège (qui ne fait pas partie de l'Union européenne) est le seul pays d'Europe à disposer de réserves importantes, même si elles représentent une part infime des réserves mondiales.
Classement des principaux pays européens producteurs de gaz naturel en 2023
En milliards de mètres cubes de gaz naturel produit - Source : Statistical Review of World Energy 2024 - Graphique : Selectra
milliards de mètres cubes
La production européenne se concentre sur quelques pays et reste anecdotique à l'échelle mondiale.
Classement des principaux pays européens exportateurs de gaz naturel en 2020
En milliards de mètres cubes de gaz naturel produit - Source : CIA World Factbook - Graphique : Selectra
milliards de mètres cubes
L'importation de gaz naturel
La France importe environ 98% de sa consommation de gaz naturel.
Provenance des importations de gaz naturel de la France
Source : Ministère de la Transition Écologique - Graphique : Selectra
En % et en TWh au passage de la souris
L'invasion de l'Ukraine par la Russie a poussé la France et l'Europe à repenser sa chaine d'approvisionnement pour se passer de gaz russe.
Ce réajustement a fait exploser la balance énergétique française et européenne, puisque les tensions ont provoqué une hausse importante des prix sur le marché. La hausse des prix avait déjà commencé quelques mois plus tôt, alors que la demande en gaz venue d'Asie avait fortement augmenté avec la reprise économique post-COVID. En outre, le GNL importé des USA, du Qatar et de l'Azerbaïdjan notamment, coûte plus cher que le gaz russe acheminé via gazoduc.
Prix du gaz naturel sur le marché de gros PEG à M+1 (Point d'échange Gaz)
Prix relevés en février 2026 - Graphique: Selectra - Source: CNR
€
On remarquera que la France n'est pas aussi dépendante de la Russie que ses voisins. La distance avec les frontières russes par rapport à celles avec la Norvège avec laquelle elle dispose d'un gazoduc d'un côté, et ses côtes atlantiques et méditerranéennes où elle dispose de terminaux de regazéification de gaz naturel liquéfié de l'autre ; lui permettent de diversifier ses approvisionnements. La dépendance vis-à-vis du gaz russe est beaucoup plus marquée dans les pays d'Europe centrale et orientale.
Classement des principaux pays européens importateurs de gaz naturel en 2020
En milliards de mètres cubes de gaz naturel produit - Source : CIA World Factbook - Graphique : Selectra
milliards de mètres cubes
Classement des cinq plus grands pays importateurs de gaz naturel en 2020
En milliards de mètres cubes de gaz naturel importé - Source : CIA World Factbook - Graphique : Selectra
milliards de mètres cubes
En imposant des sanctions à la Russie, l'Europe n'a eu le choix que de trouver d'autres pays pour importer cette énergie cruciale pour la population et les entreprises. Au-delà du renforcement des infrastructures de transport pour faire bénéficier toute l'Europe des approvisionnements venant du nord, les sources d'approvisionnement européennes se sont diversifiées en développant les infrastructures au sud de l'Europe. Ainsi, la construction de terminaux méthaniers et de gazoducs sur la côte atlantique et méditerranéenne permet d'augmenter l'approvisionnement transitant par le Maghreb, le sud de l'Europe et la France. Plus encore, l'objectif est de développer les infrastructures permettant de distribuer ces approvisionnements jusqu'en Europe de l'est afin de limiter la dépendance énergétique de l'Europe envers la Russie.
Dans l'Hexagone, les terminaux méthaniers de Fos ont vu augmenter l'approvisionnement en provenance du Maghreb et du Moyen-Orient, et celui de Montoir a accueilli une part importante du gaz de schiste américain. De même, un projet de gazoduc trans-adriatique (TAP) a été entériné pour relier l'Europe du sud au gisement gazier azerbaïdjanais.
Ces investissements font l'objet d'une politique globale au niveau européen, prenant en compte une vision à long terme des tarifs gaziers et de l'indépendance énergétique européenne. Le plan d'action, complexe, coûteux et long à mettre en place doit permettre, à terme, d'assurer la rentabilité des investissements, la pérennité des infrastructures et, in fine, la compétitivité du marché gazier européen.
Les points d'entrée du gaz naturel sur le territoire français
Il existe plusieurs points d'entrée du gaz sur le territoire, que ce soit par voie terrestre ou par voie maritime.
La France possède sept points d’interconnexions gazières principaux, la connectant avec les réseaux de ses voisins européens :
- à Dunkerque, point d’atterrage du gazoduc sous-marin Franpipe venu de Norvège ;
- à Taisnières, deux interconnexions avec la Belgique ;
- à Obergailbach, avec le réseau Allemand ;
- à Oltingue, avec la Suisse ;
- à Larrau et Biriatou, avec l'Espagne.
La France dispose également de cinq terminaux méthaniers de regazéification de GNL :
- Montoir-de-Bretagne, situé à Saint-Nazaire en région Pays de la Loire ;
- Fos-Tonkin, implanté à Fos-sur-Mer en Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
- Fos-Cavaou, également localisé à Fos-sur-Mer ;
- Dunkerque, situé à Loon-Plage dans les Hauts-de-France ;
- Le Havre, un terminal flottant récemment mis en service en Normandie.
Du fait d'une position assez centrale au sein de l'Union européenne, une partie des entrées de gaz naturel repartent hors de France pour une consommation à l'étranger. C'est ainsi que la France compte deux points de sortie de gaz principaux :
- à Oltingue (Alsace) pour livrer la Suisse ;
- et à Larrau (Aquitaine) qui livre l'Espagne.

Le transport du gaz naturel en France
Une fois sur le territoire français, le transport du gaz naturel est réalisé par GRTgaz sur la majorité du territoire, et par Téréga dans le sud-ouest.
Il repose sur un réseau de canalisations haute pression qui assure l’acheminement depuis les points d’importation et les terminaux méthaniers vers les grands centres de consommation et les stockages souterrains. Ce réseau garantit l’équilibrage du système en fonction de la demande énergétique nationale et européenne.
Le réseau de transport de gaz sur le territoire français a une longueur de plus de 32 500 kilomètres pour GRTgaz et plus de 5100 kilomètres pour Térega.
Le stockage du gaz naturel
Il existe deux principales méthodes de stockage du gaz naturel :
- le stockage souterrain, qui exploite des formations géologiques telles que :
- les cavités salines ;
- les nappes aquifères ;
- ou d’anciens gisements.
- le stockage en surface, qui repose sur :
- des réservoirs ;
- et des cuves de GNL.
Les capacités de stockage de gaz ont deux objectifs principaux :
- faire face à la saisonnalité de la consommation de gaz naturel. Le gaz est stocké en été lorsque la consommation est faible, et libéré en hiver lorsque la consommation est élevée
- garantir la sécurité d'approvisionnement, alors que la France est presque totalement dépendante de ses importations de gaz naturel.
Les capacités de stockage de gaz naturel sont opérées par les deux gestionnaires des réseaux de transport de gaz : Storengy et Térega.
La distribution du gaz naturel
Le réseau de distribution du gaz naturel permet d'acheminer le gaz à basse pression jusqu'aux compteurs de gaz des consommateurs finaux.
La longueur du réseau de distribution atteint plus de 200 000 kilomètres et sa gestion est assurée très majoritairement par GRDF, mais aussi quelques entreprises locales de distribution (ELD) dans certaines communes.
Si seulement un peu plus de 9 500 communes sont reliées au réseau de distribution de gaz naturel sur un total de 36 000 environ, près de 80 % de la population française peut avoir accès au réseau de distribution de gaz naturel.
La consommation de gaz naturel par ses usagers
La consommation de gaz naturel tend à baisser d'année en année, et la tendance s'est accentuée ces dernières années avec la hausse des prix et les incitations gouvernementales à passer à des modes de chauffages plus respectueux de l'environnement.
On distingue quatre principaux usages :
- le résidentiel pour la production d'eau chaude sanitaire, le chauffage et la cuisson.
- l'industriel essentiellement pour l'industrie chimique.
- les centrales thermiques de production d'électricité à partir de gaz naturel, qui constituent le moteur de la hausse de la consommation de gaz naturel dans les pays de l'OCDE.
- les transports avec le GNV.
Rémunération des acteurs du gaz
Pour comprendre le financement du marché du gaz en France, il est intéressant de décomposer une facture de gaz.
Postes de coûts couverts par le Prix Repère de la CRE - Client T2, en %
Données à jour en août 2025 pour le mois de septembre 2025 - T2 correspond à une utilisation du gaz pour le chauffage - Pour une consommation de 11 510 kWh/an - Source : CRE - Graphique : Selectra
%
Le prix du gaz payé par les consommateurs particuliers français se décompose de la façon suivante :
- Le prix de la fourniture de gaz couvre les coûts d'approvisionnement et les coûts de commercialisation ;
- Le tarif d'utilisation des réseaux de transport de gaz (ATRT) qui couvre les coûts d'investissement et d'exploitation des gestionnaires des réseaux de transport de gaz ;
- Le tarif d'utilisation des réseaux de distribution de gaz (ATRD) qui couvre les coûts d'investissement et d'exploitation des gestionnaires des réseaux de distribution de gaz ;
- Le tarif d'utilisation des réseaux de stockage du gaz (ATS) ;
- Et différentes taxes sur le gaz : l'accise sur les gaz naturels (ex TICGN), la CTA (Contribution Tarifaire d'Acheminement) et la TVA sur le gaz.
